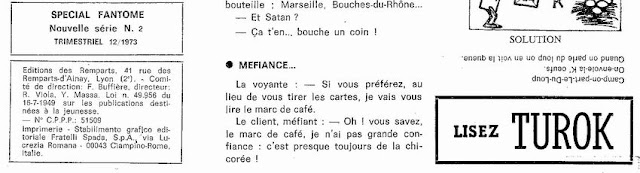La semaine dernière (le 17 juin 2016 pour être exact), l'éditeur
Mnémos terminait une campagne de financement participatif au succès fulgurant et monstrueusement efficace, culminant à près de 1600% (mille six-cent!). La raison? Il s'agissait de publier, pour la première fois en France, l'intégrale des récits
fantasy de
Clark Ashton Smith, la dernière tête de la sainte trinité de
Weird Tales, grand ami d'
Howard Philip Lovecraft et
Robert E. Howard.
À sa mort en 1961,
Klarkash-Ton, ainsi que le surnommait
Lovecraft, était encore totalement inconnu en France. La situation de ses compères n'était pas beaucoup plus reluisante, puisque
Howard n'avait pas encore eu droit à une publication française (
Conan ne sera traduit qu'en 1972) et que
Lovecraft lui-même commençait à peine à pointer le bout de son nez (suite à la parution de
La Couleur tombée du ciel chez
Denoel (
Présence du Futur #4) en 1954). Il fallait, pour ce type de littérature très connotée, compter sur les collections poches, et c'est la science-fiction qui était alors en vogue, notamment grâce à la machine
Fleuve Noir Anticipation. Le fantastique était un genre qu'on réservait volontiers aux auteurs du XIXème et la
fantasy, patiemment, attendait son heure (
Le Hobbit ne verra sa première traduction en France qu'en 1969,
Le Seigneur des Anneaux en 72, et si les cycles SF de
Poul Anderson font alors un malheur -
Les Croisés du Cosmos, 1962 ;
La Patrouille du temps, 1965-, son "manifeste"
fantasy,
Trois Coeurs Trois Lions, ne sera traduit qu'en 1986 -son pendant nordique,
L'Epée brisée, contemporain des
Anneaux et considéré à juste titre comme une des pièces premières de la
fantasy moderne, attendra quant à lui 2014, c'est dire).
Et puis au delà du genre auquel il appartient et ses origines
pulp, il y a une petite chose extrêmement importante à prendre en compte concernant Smith : aux Etats-Unis, il fut surtout considéré comme un poète. Qui plus est, sa courte carrière (1912-1935, il arrêta d'écrire après les décès successifs de ses deux compères pour se consacrer à la sculpture) n'en fit pas un auteur spécialement prolifique. La publication de
Clark Ashton Smith le noveliste s'avère donc être un affaire d'archiviste des deux côtés de l'Atlantique. Débutée en 1970 avec la parution de
Zothique chez
Balantine (au format
paperback, équivalent local du poche, et avec de superbes couvertures de
Bruce Pennington), il fallut attendre les recueils de
Night Shade Books (
The Collected Fantasies of Clark Ashton Smith) publiés entre 2007 et 2008 pour voir l'intégralité des écrits fantastiques de l'auteur compilés dans sa langue d'origine.
En France, l'aventure éditoriale de
Smith commence sensiblement au même moment : un premier et gros volume,
Autres Dimensions, était publié chez
Christian Bourgois en 1971. Il est intéressant de noter qu'il ne contient aucun des récits les plus connus du monsieur, rassemblant des nouvelles éthérés assez proches de ses écrits poétiques. Confidentiel et jamais réédité, il appartient aujourd'hui à cette catégorie de livres fantômes absolument introuvables, sinon à prix d'or. Il faudra en fait attendre les années 80 pour que
C.A. Smith se trouve un public en francophonie. Bien aidée par le succès de
Conan en salles, l'
heroic fantasy explose, et quoi de mieux pour capitaliser sur la soudaine reconnaissance d'
Howard que de publier l'un de ses grands amis ? La
Librairie des Champs Elysées s'était chargé d'ouvrir le terrain en traduisant deux des volumes de 1970 de
Balantine,
Zothique (1978) et
Poséidonis (1981), curieusement tronqués de certaines nouvelles, dans sa collection
Le Masque Fantastique (qui verra par la suite également apparaître
Lovecraft à son catalogue), mais c'est surtout entre 1985 et 1989 que
Smith prend pied dans l'hexagone, lorsque les
Nouvelles Editions Oswald en publient huit volumes (
L'Ile inconnue, Ubbo Sathla, L'Empire des nécromants, La Gorgone, Le Dieu carnivore (en deux tomes),
Les Abominations de Yondo et
Morthylla). Le succès est au rendez-vous et, si elle n'est pas aussi invisible que les
Autres Dimensions de 1971, cette série est désormais au moins aussi chère, avec des tarifs qui peuvent varier entre 80 et 150€ (pièce!) sur les sites d'enchères. A raison, quelque part, car non contente de proposer alors un éventail quasi complet des nouvelles
fantasy et fantastique de Smith,
NéO se paye le luxe de couvertures
pulp hautement qualitatives (par
Jean-Michel Nicollet, j'en ai déjà parlé) et, surtout, de textes explicatifs fourmillant d'informations. Il est à ce titre important de noter que
NéO fit de même avec les récits moins connus d'
Howard (publiant, en fait, la totalité de ceux qui ne concernent pas
Conan), et offrit également une nouvelle vitrine à
Lovecraft (alors au fait de sa popularité suite à la traduction du jeu de rôle
L'Appel de Cthulhu).
Parallèlement, on soulignera l'entêtement avec lequel
Jacques Sadoul fera la promotion de l'auteur dans ses nombreuses anthologies
pulp (
Les Meilleures récits de...) des années 70 et 80 et jusqu'à son
Histoire de la Science-Fiction en 2000, publiant (entre autres) pas moins de trois fois
La Mort d'Illalotha, qui reste l'un des textes les plus populaires de
Smith (et dont le style très graphique en fait à mes yeux l'une des principales inspirations de la scène de la mort de Lucy dans le
Dracula de
Coppola).
Après 1989, toutefois, un lourd silence s'abat sur l'oeuvre de
Smith.
Quelques petits éditeurs s'essaient à des publications plus ou moins artistiques, à l'image de
L'Oeil du Sphinx, désireux de faire découvrir aux lecteurs francophones sa poésie encore confidentielle (tout juste un texte ou deux dans la revue
Antarès en 1979), ou son travail pictural, mais sans grande publicité ni réel impact public.
La Clef d'Argent publiera par ailleurs l'intégrale de ses poèmes dans
Nostalgie de l'inconnu en 1990 (réédité en 2001), et une plus qu'intrigante quoique terriblement courte (une cinquantaine de pages) étude intitulée
Les Mondes perdus de Clark Ashton Smith en 2004 (réédité en 2007).
Et puis, soudain, en 2013, parait
La Flamme chantante chez
Actes Sud. Un projet étrange, agrémenté d'une nouvelle traduction, publié dans un format plaquette (étroit et haut) relativement cher (quinze euros pour une centaine de pages) plus que surprenant. Une belle oeuvre, très franchement, et qui marque le retour de
Smith chez un grand éditeur, mais qui m'a toujours semblé assez vaine : quoique disposant d'une nouvelle traduction et d'un format original, elle n'en reste pas moins une simple version de luxe d'une nouvelle qu'on trouvait déjà non seulement chez
NéO (dans
L'Ile inconnue) mais aussi et surtout chez
Sadoul (dans
Les Meilleurs récits de Wonder Stories, magazine où elle fut publiée en deux parties en juillet et novembre 1931) pour trois fois rien. Le choix du récit en lui-même est par ailleurs assez significatif de la relative incompréhension de la francophonie pour
Klarkash-Ton. Publiée, je viens de le dire, dans
Wonder Stories plutôt dans
Weird Tales,
La Flamme chantante s'approche plus de la
science-fantasy rêveuse d'
Abraham Merritt (jusqu'aux dimensions parallèles pour encadrer le récit, à l'image de
La Nef d'Ishtar ou du
Gouffre de la Lune) que du fantastique fantômatique qu'on connait de
Smith.
Alors... Alors trois ans après l'étrange expérience d'
Actes Sud,
Mnémos lançait une
campagne Ulule pour une nouvelle traduction de l'intégralité des textes de
Smith, et bouclait son financement en quelques heures (ressemblant au final près de 80 000 euros sur les 4000 demandés), histoire de (se) prouver que
Smith, malgré une édition plus que chaotique en France, n'est pas un auteur à deux sous. Pour la première fois, les cycles
Zothique (le continent de la fin des temps) et
Hyperborée (terre d'horreurs cosmiques lovecraftienne et de barbares howardiens) seront accompagnés d'
Averoigne (cycle gallo-romain ironiquement totalement inconnu en France ou presque) et
Poséidonis (évidente et théologique Atlantis), en entier, nouvelles et poèmes confondus, dans un format luxe, cartographié, et abondamment illustré (à titre posthume) par
Zdzislaw Beksinski, artiste surréaliste polonais plus que recommandable. J'ai hâte.