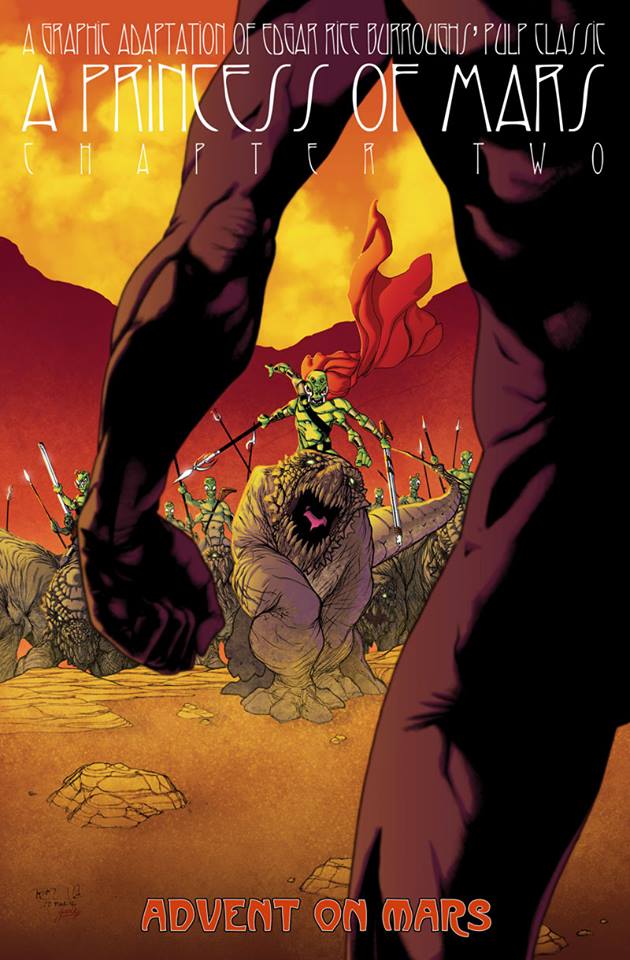Inspiré par les objets souvent étranges (et surtout non-identifiés) qui traînent parfois dans le désert, Sterling Ruby a installé Specter, un monolithe orange ultra-bright (c'est fait avec de l'aluminium et destiné à refléter le décor alentour) dans la vallée de Coachella aux Etats-Unis, à l'occasion de l'évènement Desert X.
Et je sais pas si c'est juste moi, mais ce truc, sensé évoquer la lutte entre naturel et artificiel, m'en rappelle si fort un autre que je me prends à rêver d'un roman avec ce gros BDO fluo devant les meilleurs scientifiques du XIXème siècle. Old west meets aliens.
Ou alors ça fera une jolie pochette pour un groupe de desert/stoner rock.
Affichage des articles dont le libellé est Tous à l'ouest. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Tous à l'ouest. Afficher tous les articles
dimanche 10 mars 2019
samedi 28 mai 2016
Jour 27 – Film bédéphile favori ?
J'avais succinctement fait part de mon problème concernant cette question au moment d'aborder les "dessins animés" de la question 11. Mes films adaptés de bédés favoris sont tous, sans aucune exception, des films d'animation. Même Marvel et DC (surtout DC -c'est la Warner, hein-) m'intéressent plus animés qu'en prise de vue réelle. Ainsi donc, dans une collection où figurent du Asterix et du Tintin en pagaille et où, de très loin, mon film de super-héros ultime se trouve être Les Indestructibles (j'ai aussi un faible pour le Wonder Woman de 2009), mon absolue référence, c'est Lucky Luke. Le film de 1971 de Belvision, hein, pas le Terrence Hill. "Animé", j'ai dit.
C'est l'un des films que j'ai le plus vu étant môme, c'est un de mes personnages favoris tout média confondu, et ce serait mon film favori de l'histoire du monde planétaire, bar none, si le hasard ne m'avait pas mis un jour devant Tombstone (oui, je suis un cow-boy). Lucky Luke (que je vais appeler Daisy Town à partir de maintenant pour des raisons de commodité), c'est quelque chose dont je ne me suis jamais lassé. C'est drôle, fin, aventureux, avec un héros qui, sous sa mèche et avec sa clope de taiseux, a environ douzemille fois plus de personnalité que bien des hurleurs surexcités de films d'animation moderne.
La scène bien évidement gravée dans ma mémoire (et j'ai la musique en tête rien que d'y penser), c'est la construction de la ville au début, monument d'humour absurde et de situations incongrues, reproduite à la frame près par Hill vingt ans plus tard dans sa reprise mélancolique du personnage. (Je pourrais en dire des kilos sur ce film, mais je m'arrêterais à cette remarque. Reprenons plutôt.) Mais il y a bien plus que l'humour meta de l'immense René Goscinny dans ce film.
Il respecte à la lettre (et c'est précisément ce qui le rend drôle) une description désuète de l'ouest légendaire, avec ses preux chevaliers de la justice parcourant les plaines sur leurs étalons, et "les bandits, les desperados, la racaille, les chevaliers de la violence et du vice" (avec une ligne de basse de l'enfer) qui en font une mine à histoire toutes plus invraisemblables les unes que les autres. Celle-ci est originale, mais intègre nombre de personnages croisés (ou à croiser) dans les aventures de papier, et s'avère même être une des meilleures du personnage. En fait, au delà du bête amour que j'ai pour Lucky Luke, le fait qu'il soit ainsi apparu au cinéma, héros qu'il est d'un genre éminemment lié au grand écran, témoigne bien de son importance.
Au delà de ça, il y a bien évidemment l'intérêt même du format cinéma. Le choix d'un scénario original s'est fait avant tout de par la nécessité d'avoir des gags, des dialogues, et surtout un rythme de narration qui soit propre au média (une question qui est bien souvent éludée par les armées de fans dans notre ère moderne d'adaptations littéraires à tout va, au nom d'un "respect" absurde et incompatible avec l'entreprise).
L'autre raison, qu'on garde généralement plus discrète, c'est qu'il y avait la place pour le faire. Daisy Town s'est en effet tourné avec un budget faramineux pour l'époque et ce type de produit : quatre millions et demi de francs (ajusté à l'inflation, ça fait à peu près autant d'euros aujourd'hui). Il faut dire que Belvision avait fait les choses bien : si Goscinny (et son copain Uderzo) s'était fait pour ainsi dire voler Asterix en 1967 pour Asterix le Gaulois, il avait vite récupérer les reines des versions animées de ses oeuvres (il est d'ailleurs crédité comme réalisateur de tous les films adaptés de ses BDs - à l'exception d'Asterix le Gaulois, évidemment), bien aidé par un grand monsieur de la télévision, un certain Pierre Tchernia. C'est Tchernia qui avait négocié pour Asterix chez Cléopatre (1968), et c'est lui qui débloquera l'argent pour Daisy Town. Autre détail d'importance, décidé en 1969, le film bénéficie de deux ans pour se faire. C'est quatre fois plus qu'Asterix chez Cléopatre (entre temps, Belvision sortira Tintin et le Tempe du Soleil). Ainsi donc, quand le projet Daisy Town démarre, tout ce beau monde est fin prêt et sait ce qu'il fait et a à faire. Et Goscinny de proposer ce scénario simple mais bourré d'idées à son compère.
L'idée était, vu la difficulté de l'entreprise, d'avoir la trame la plus modulable qui soit et de travailler une multitude de petites scènes pour pouvoir les adapter au mieux tant au style de l'artiste qu'aux règles du cinéma.
En terme de caractérisation, c'est là que se passent des choses dingues qui font frétiller mes moustaches aujourd'hui et qui participaient à la magie quand j'étais p'tit : Lucky Luke n'était jusque là jamais apparu ne serais-ce qu'à la télé, le personnage n'avait jamais pensé pour être animé, et il fallait donc repenser sa gestuelle tout en conservant ce qui faisait de lui... lui. De là découle ce qui deviendra le look iconique du personnage, avec le trait ultra stylisé de Morris, qui n'avait jusqu'alors cessé d'évoluer et de tester de nouvelles choses dans les bandes dessinées (voyez la façon dont le style séquentiel du monsieur se fige peu à peu entre 1969 et 71 pour vous en convaincre -une métamorphose qui avait d'ailleurs commencée en 1965 avec Le 20ème de cavalerie-). Il sera simplifié pour les besoin de l'animation (les coutures du pantalon, par exemple, disparaîtront) mais la silhouette générale restera. Et puis il y a la voix et la diction. Habituellement discret mais prolixe, Luke devient alors un héros monosyllabique ("Ouaip."), renforçant son image de solitaire mythique. En fait, le film lui-même est majoritairement muet.
Un exemple concret de tout ça, c'est la scène du duel, aux sons répétitifs et agressifs, et à la lenteur exacerbée. Tout y est amplifié, dilaté, la scène est pensée cinématographiquement pesante. En BD, ça ferait peut-être deux planches, l'oeil les scannerait en quelques instants et passerait à la suite. Ici, ça dure quatre pleines et longues minutes, jusqu'à la compréhension du gag, et la courte attente avant la libération. C'est grandiose, et c'est la meilleure scène du film.
Et à chaque nouveau visionnage du film, je remarque et/ou me souviens de nouveaux et nombreux détails de ce genre. Parfait exemple de ces oeuvres qu'on peut apprécier à n'importe-quel âge et à des degrés radicalement différents, Daisy Town est une adaptation monumentale, un film qui a parfaitement compris à quels niveaux il doit être proche et différent de son support d'origine, fruit du travail de gens dont le talent n'est plus à démontrer.
Pour preuve, quand, en 1983, il entrera à la postérité séquentielle en étant adapté par son auteur lui même (c'est à cette occasion qu'il prendra le nom Daisy Town), la plupart des gags visuels seront largement diminués, et, évidemment, la totalité des auditifs passeront à la trappe. Daisy Town est un film, et un grand film.
C'est l'un des films que j'ai le plus vu étant môme, c'est un de mes personnages favoris tout média confondu, et ce serait mon film favori de l'histoire du monde planétaire, bar none, si le hasard ne m'avait pas mis un jour devant Tombstone (oui, je suis un cow-boy). Lucky Luke (que je vais appeler Daisy Town à partir de maintenant pour des raisons de commodité), c'est quelque chose dont je ne me suis jamais lassé. C'est drôle, fin, aventureux, avec un héros qui, sous sa mèche et avec sa clope de taiseux, a environ douzemille fois plus de personnalité que bien des hurleurs surexcités de films d'animation moderne.
La scène bien évidement gravée dans ma mémoire (et j'ai la musique en tête rien que d'y penser), c'est la construction de la ville au début, monument d'humour absurde et de situations incongrues, reproduite à la frame près par Hill vingt ans plus tard dans sa reprise mélancolique du personnage. (Je pourrais en dire des kilos sur ce film, mais je m'arrêterais à cette remarque. Reprenons plutôt.) Mais il y a bien plus que l'humour meta de l'immense René Goscinny dans ce film.
Il respecte à la lettre (et c'est précisément ce qui le rend drôle) une description désuète de l'ouest légendaire, avec ses preux chevaliers de la justice parcourant les plaines sur leurs étalons, et "les bandits, les desperados, la racaille, les chevaliers de la violence et du vice" (avec une ligne de basse de l'enfer) qui en font une mine à histoire toutes plus invraisemblables les unes que les autres. Celle-ci est originale, mais intègre nombre de personnages croisés (ou à croiser) dans les aventures de papier, et s'avère même être une des meilleures du personnage. En fait, au delà du bête amour que j'ai pour Lucky Luke, le fait qu'il soit ainsi apparu au cinéma, héros qu'il est d'un genre éminemment lié au grand écran, témoigne bien de son importance.
Au delà de ça, il y a bien évidemment l'intérêt même du format cinéma. Le choix d'un scénario original s'est fait avant tout de par la nécessité d'avoir des gags, des dialogues, et surtout un rythme de narration qui soit propre au média (une question qui est bien souvent éludée par les armées de fans dans notre ère moderne d'adaptations littéraires à tout va, au nom d'un "respect" absurde et incompatible avec l'entreprise).
L'autre raison, qu'on garde généralement plus discrète, c'est qu'il y avait la place pour le faire. Daisy Town s'est en effet tourné avec un budget faramineux pour l'époque et ce type de produit : quatre millions et demi de francs (ajusté à l'inflation, ça fait à peu près autant d'euros aujourd'hui). Il faut dire que Belvision avait fait les choses bien : si Goscinny (et son copain Uderzo) s'était fait pour ainsi dire voler Asterix en 1967 pour Asterix le Gaulois, il avait vite récupérer les reines des versions animées de ses oeuvres (il est d'ailleurs crédité comme réalisateur de tous les films adaptés de ses BDs - à l'exception d'Asterix le Gaulois, évidemment), bien aidé par un grand monsieur de la télévision, un certain Pierre Tchernia. C'est Tchernia qui avait négocié pour Asterix chez Cléopatre (1968), et c'est lui qui débloquera l'argent pour Daisy Town. Autre détail d'importance, décidé en 1969, le film bénéficie de deux ans pour se faire. C'est quatre fois plus qu'Asterix chez Cléopatre (entre temps, Belvision sortira Tintin et le Tempe du Soleil). Ainsi donc, quand le projet Daisy Town démarre, tout ce beau monde est fin prêt et sait ce qu'il fait et a à faire. Et Goscinny de proposer ce scénario simple mais bourré d'idées à son compère.
L'idée était, vu la difficulté de l'entreprise, d'avoir la trame la plus modulable qui soit et de travailler une multitude de petites scènes pour pouvoir les adapter au mieux tant au style de l'artiste qu'aux règles du cinéma.
En terme de caractérisation, c'est là que se passent des choses dingues qui font frétiller mes moustaches aujourd'hui et qui participaient à la magie quand j'étais p'tit : Lucky Luke n'était jusque là jamais apparu ne serais-ce qu'à la télé, le personnage n'avait jamais pensé pour être animé, et il fallait donc repenser sa gestuelle tout en conservant ce qui faisait de lui... lui. De là découle ce qui deviendra le look iconique du personnage, avec le trait ultra stylisé de Morris, qui n'avait jusqu'alors cessé d'évoluer et de tester de nouvelles choses dans les bandes dessinées (voyez la façon dont le style séquentiel du monsieur se fige peu à peu entre 1969 et 71 pour vous en convaincre -une métamorphose qui avait d'ailleurs commencée en 1965 avec Le 20ème de cavalerie-). Il sera simplifié pour les besoin de l'animation (les coutures du pantalon, par exemple, disparaîtront) mais la silhouette générale restera. Et puis il y a la voix et la diction. Habituellement discret mais prolixe, Luke devient alors un héros monosyllabique ("Ouaip."), renforçant son image de solitaire mythique. En fait, le film lui-même est majoritairement muet.
Un exemple concret de tout ça, c'est la scène du duel, aux sons répétitifs et agressifs, et à la lenteur exacerbée. Tout y est amplifié, dilaté, la scène est pensée cinématographiquement pesante. En BD, ça ferait peut-être deux planches, l'oeil les scannerait en quelques instants et passerait à la suite. Ici, ça dure quatre pleines et longues minutes, jusqu'à la compréhension du gag, et la courte attente avant la libération. C'est grandiose, et c'est la meilleure scène du film.
Vous excuserez le format tronqué de l'image, Youtube aime le 16/9...
Et à chaque nouveau visionnage du film, je remarque et/ou me souviens de nouveaux et nombreux détails de ce genre. Parfait exemple de ces oeuvres qu'on peut apprécier à n'importe-quel âge et à des degrés radicalement différents, Daisy Town est une adaptation monumentale, un film qui a parfaitement compris à quels niveaux il doit être proche et différent de son support d'origine, fruit du travail de gens dont le talent n'est plus à démontrer.
Pour preuve, quand, en 1983, il entrera à la postérité séquentielle en étant adapté par son auteur lui même (c'est à cette occasion qu'il prendra le nom Daisy Town), la plupart des gags visuels seront largement diminués, et, évidemment, la totalité des auditifs passeront à la trappe. Daisy Town est un film, et un grand film.
mercredi 4 mai 2016
Jour 03 – Une bédé méconnue ?
Où se pose une question pourtant évidente : comment sait-on si une série est méconnue ? On se fie à ses chiffres de ventes ? A l'absence de critique ?
La question originale disait "underrated". Quand j'ai traduit, j'ai choisi de le faire dans son sens commun, mais underrated peut aussi très littéralement signifier "sous-évalué", et ça ne veut pas dire la même chose du tout. L'idée de sous-évaluation passe forcément par le spectre de l'appréciation de la série en question, c'est assez compréhensible et souvent définitif. La méconnaissance, c'est très aléatoire, et des séries méconnues, y en a des kilos, oubliées par le public ou la critique, voire par leurs éditeurs eux-même, sans qu'on en sache toujours vraiment la raison, mais qui valent pourtant amplement la peine. Et évidemment, me sont passés par la tête quelques exemples assez fameux, des multiples mini-séries consacrées au groupe Agents of Atlas (des Vengeurs pulp) par Jeff Parker que Marvel n'a jamais promotionné, à des choses plus intrigantes comme l'excellent Gotham Central de Greg Rucka et Ed Brubaker, ou Planetary, le manifeste pop et pulp de Warren Ellis (dont je reparlerai, soyez-en sûrs), deux séries qui furent encensées par la critique mais aux chiffres de vente abyssaux. L'excellent Cat Shit One de Motofumi Kobayashi aussi, pour citer autre chose que de l'américain.
Mon petit préféré, toutefois, c'est Loveless.
Loveless est un four, et c'est presque un cas d'école. Pourtant, sur le papier, il y avait tout pour que ça marche : c'était signé de deux auteurs à succès, Brian Azzarello et Marcelo Frusin, qui sortaient alors d'un excellent passage sur Hellblazer, c'était édité par Vertigo, avec l'étiquette adulte qui va avec, et c'était vendu comme une longue série à la fin préméditée, à l'image d'100 Bullets, un autre comics à succès d'Azzarello. Mais... Mais Loveless est un western, et un western, en 2005, c'était sûr de se planter. Ajoutez au sujet de base le fait qu'il ai fallu quatre ans et trois dessinateurs pour publier un maigre total de vingt-quatre épisodes, et vous comprenez l'ampleur de désastre.
Il se ressent évidemment très puissamment à la lecture, expédiée sur ses derniers numéros, après que Vertigo ait décidé de limiter les frais. Azzarello avait prévu un cycle monumental devant courir de la fin de la Guerre de Sécession à la Deuxième Guerre Mondiale, étalé sur une cinquantaine d'épisodes. Finalement, si le premier story-arc sortit dans les temps, les calendriers des uns et des autres eurent raison des intentions de départ. Frusin dut vite être remplacé par Daniel Zezelj, dessinateur rapide mais brouillon avec lequel Azzarello avait déjà collaboré sur El Diablo (un western fantastique), lui-même étant parfois suppléé par Werther Dell'Edera, fill-in artist à la régularité exemplaire qu'on a, lui aussi, vu sur du Hellblazer, en l'occurrence le graphic novel Dark Entries d'Ian Rankin (Vertigo est une grande famille...) L'intelligence d'Azzarello lui permettra d'utiliser l'alternance des dessinateurs avec un certain dynamisme narratif, mais les délais de publication entre les arcs n'en étaient pas moins importants.
De manière assez curieuse (ou pas, d'ailleurs), la série illustre plutôt bien l'anarchie créative dans laquelle elle fut publiée. Western nihiliste au possible, dont le héros, si tant est qu'on puisse l'appeler ainsi, disparaît très rapidement, il se centre plutôt sur des questions historiques et sociales, les personnages servant en vérité de vecteurs d'idées et de leviers narratifs bien plus que de réels acteurs. N'allez pas croire qu'ils sont mal pensés et que la chose n'ait que peu d'intérêt, néanmoins, puisque Loveless, malgré tous ses soucis éditoriaux et le rush palpable de ses derniers épisodes, n'en reste pas moins très complet, Azzarello y jouant de ses fixettes récurrentes, notamment l'Histoire américaine et le rapport de ses habitants à cette Histoire, et offrant un panel de personnages hauts en couleurs, quoiqu'aux motivations particulièrement opaques.
Loveless, au titre étrangement évocateur, est une bande-dessinée paradoxale. C'est très très particulier à lire, à la fois verbeux à l'excès et taiseux jusqu'à l'incompréhension, avec un scénario forcément concentré par un run raccourci mais narrativement dilaté à l'extrême, ça n'a l'air de mener à rien et pourtant à un moment tout fait sens. Evidemment, les interminables délais entre les épisodes ont rendu la chose totalement incompréhensible pour les lecteurs du moment, mais en TPB (trois volumes, dont un seul a été traduit en français), c'est étonnement solide, et c'est très honnêtement une de mes bédés favorites, tous genres confondus...
Malgré tout, j'aurais toutes les peines du monde à le recommander à qui que ce soit. C'est vraiment compliqué à lire, et s'il est à moitié oublié aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. Son insuccès en fait en plus quelque-chose de plutôt difficile à trouver, quoique sa côte soit restée relativement basse.
Si vous voulez un demi successeur moderne, s'attardant sur les même questions mais dans une réserve indienne du XXIème siècle et ajoutant au côté western un fort relent de polar mafieux, vous pouvez vous essayer à Scalped, de Jason Aaron. Ca aussi, ça aurait fait une bonne entrée méconnue.
La question originale disait "underrated". Quand j'ai traduit, j'ai choisi de le faire dans son sens commun, mais underrated peut aussi très littéralement signifier "sous-évalué", et ça ne veut pas dire la même chose du tout. L'idée de sous-évaluation passe forcément par le spectre de l'appréciation de la série en question, c'est assez compréhensible et souvent définitif. La méconnaissance, c'est très aléatoire, et des séries méconnues, y en a des kilos, oubliées par le public ou la critique, voire par leurs éditeurs eux-même, sans qu'on en sache toujours vraiment la raison, mais qui valent pourtant amplement la peine. Et évidemment, me sont passés par la tête quelques exemples assez fameux, des multiples mini-séries consacrées au groupe Agents of Atlas (des Vengeurs pulp) par Jeff Parker que Marvel n'a jamais promotionné, à des choses plus intrigantes comme l'excellent Gotham Central de Greg Rucka et Ed Brubaker, ou Planetary, le manifeste pop et pulp de Warren Ellis (dont je reparlerai, soyez-en sûrs), deux séries qui furent encensées par la critique mais aux chiffres de vente abyssaux. L'excellent Cat Shit One de Motofumi Kobayashi aussi, pour citer autre chose que de l'américain.
Mon petit préféré, toutefois, c'est Loveless.
Loveless est un four, et c'est presque un cas d'école. Pourtant, sur le papier, il y avait tout pour que ça marche : c'était signé de deux auteurs à succès, Brian Azzarello et Marcelo Frusin, qui sortaient alors d'un excellent passage sur Hellblazer, c'était édité par Vertigo, avec l'étiquette adulte qui va avec, et c'était vendu comme une longue série à la fin préméditée, à l'image d'100 Bullets, un autre comics à succès d'Azzarello. Mais... Mais Loveless est un western, et un western, en 2005, c'était sûr de se planter. Ajoutez au sujet de base le fait qu'il ai fallu quatre ans et trois dessinateurs pour publier un maigre total de vingt-quatre épisodes, et vous comprenez l'ampleur de désastre.
Il se ressent évidemment très puissamment à la lecture, expédiée sur ses derniers numéros, après que Vertigo ait décidé de limiter les frais. Azzarello avait prévu un cycle monumental devant courir de la fin de la Guerre de Sécession à la Deuxième Guerre Mondiale, étalé sur une cinquantaine d'épisodes. Finalement, si le premier story-arc sortit dans les temps, les calendriers des uns et des autres eurent raison des intentions de départ. Frusin dut vite être remplacé par Daniel Zezelj, dessinateur rapide mais brouillon avec lequel Azzarello avait déjà collaboré sur El Diablo (un western fantastique), lui-même étant parfois suppléé par Werther Dell'Edera, fill-in artist à la régularité exemplaire qu'on a, lui aussi, vu sur du Hellblazer, en l'occurrence le graphic novel Dark Entries d'Ian Rankin (Vertigo est une grande famille...) L'intelligence d'Azzarello lui permettra d'utiliser l'alternance des dessinateurs avec un certain dynamisme narratif, mais les délais de publication entre les arcs n'en étaient pas moins importants.
De manière assez curieuse (ou pas, d'ailleurs), la série illustre plutôt bien l'anarchie créative dans laquelle elle fut publiée. Western nihiliste au possible, dont le héros, si tant est qu'on puisse l'appeler ainsi, disparaît très rapidement, il se centre plutôt sur des questions historiques et sociales, les personnages servant en vérité de vecteurs d'idées et de leviers narratifs bien plus que de réels acteurs. N'allez pas croire qu'ils sont mal pensés et que la chose n'ait que peu d'intérêt, néanmoins, puisque Loveless, malgré tous ses soucis éditoriaux et le rush palpable de ses derniers épisodes, n'en reste pas moins très complet, Azzarello y jouant de ses fixettes récurrentes, notamment l'Histoire américaine et le rapport de ses habitants à cette Histoire, et offrant un panel de personnages hauts en couleurs, quoiqu'aux motivations particulièrement opaques.
Loveless, au titre étrangement évocateur, est une bande-dessinée paradoxale. C'est très très particulier à lire, à la fois verbeux à l'excès et taiseux jusqu'à l'incompréhension, avec un scénario forcément concentré par un run raccourci mais narrativement dilaté à l'extrême, ça n'a l'air de mener à rien et pourtant à un moment tout fait sens. Evidemment, les interminables délais entre les épisodes ont rendu la chose totalement incompréhensible pour les lecteurs du moment, mais en TPB (trois volumes, dont un seul a été traduit en français), c'est étonnement solide, et c'est très honnêtement une de mes bédés favorites, tous genres confondus...
Malgré tout, j'aurais toutes les peines du monde à le recommander à qui que ce soit. C'est vraiment compliqué à lire, et s'il est à moitié oublié aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. Son insuccès en fait en plus quelque-chose de plutôt difficile à trouver, quoique sa côte soit restée relativement basse.
Si vous voulez un demi successeur moderne, s'attardant sur les même questions mais dans une réserve indienne du XXIème siècle et ajoutant au côté western un fort relent de polar mafieux, vous pouvez vous essayer à Scalped, de Jason Aaron. Ca aussi, ça aurait fait une bonne entrée méconnue.
mercredi 30 janvier 2013
Random work of wow : Jonah Hex
J'aurais sans doute pu (du?) étayer un peu mon propos sur l'étrangeté du Jonah Hex post-apo, son histoire, tout ça, mais voyez-vous, là est justement tout l'intérêt du personnage : Jonah Hex n'a pas besoin d'histoire, comme nous le démontre avec beaucoup d'à-propos le toujours très pulp Francesco Francavilla.
mardi 29 janvier 2013
Riders of the Purple Sage
Parfois, au hasard, on tombe sur de chouettes choses.
Riders of the Purple Sage est un vieux roman. Ecrit en 1912 par Zane Grey, il est considéré comme l'oeuvre majeure du western et celui qui popularisa la recette classique du genre. Produit par ses vedettes (Ed Harris et sa compagne, Amy Madigan), Riders of the Purple Sage est aussi un téléfilm de 1996, cinq ou sixième adaptation du roman (la première date de 1918 et une version de 1925 affichait rien moins que Tom Mix dans le rôle principal), et un beau téléfilm. La photo y est superbe, éclairée naturellement par des paysages grandioses, et porté par un scénario qui ne cache pas son âge, mêlant aux plus grosses ficelles du mélodrame populaire les plus beaux archétypes du western américain.
Et on se prend au jeu des références.
Le mystérieux vengeur qui débarque dans le ranch tenu par une jeune femme seule contre tous, n’est pas sans évoquer le Pale Rider biblique d'Eastwood. Avec son look d’épouvantail efflanqué, son regard hanté et son étrange perruque, Ed Harris est une de ces silhouettes dont on se raconte la légende au coin du feu. Seulement, là où la figure fantomatique de Clint déambulait, désincarnée, dans un paysage de mort, Ed Harris est bel et bien humain, animé par une vengeance qu'il couve depuis des années et par l'amour qu'il éprouve pour Amy Madigan dans le rôle d'une femme au passé pas si différent.
Evidemment, il y a aussi dans Riders of the Purple Sage de ces conventions télévisuelles qui font sa nature. Les méchants sont très méchants, l'amour est toujours vainqueur et lorsque le héros dégaine, dans le dernier quart d'heure, l'arme qu'il avait juré de ne plus utiliser, c'est l'Apocalypse. Ou quelque chose comme ça.
Riders of the Purple Sage est de ces bons westerns qui n'ont ni la possibilité ni la prétention d'être autre chose qu'un bon western. Plein de belles images et de caractères trempés aux paroles aussi simples que leurs costumes. La réalisation est propre, les accessoires sonnent authentique, le casting est excellent. Riders of the Purple Sage est un film à voir. Vraiment.
Riders of the Purple Sage, enfin, s'appelle Les Cavaliers de la Mort en français. Les voix du Seigneur...
Et on se prend au jeu des références.
Le mystérieux vengeur qui débarque dans le ranch tenu par une jeune femme seule contre tous, n’est pas sans évoquer le Pale Rider biblique d'Eastwood. Avec son look d’épouvantail efflanqué, son regard hanté et son étrange perruque, Ed Harris est une de ces silhouettes dont on se raconte la légende au coin du feu. Seulement, là où la figure fantomatique de Clint déambulait, désincarnée, dans un paysage de mort, Ed Harris est bel et bien humain, animé par une vengeance qu'il couve depuis des années et par l'amour qu'il éprouve pour Amy Madigan dans le rôle d'une femme au passé pas si différent.
Evidemment, il y a aussi dans Riders of the Purple Sage de ces conventions télévisuelles qui font sa nature. Les méchants sont très méchants, l'amour est toujours vainqueur et lorsque le héros dégaine, dans le dernier quart d'heure, l'arme qu'il avait juré de ne plus utiliser, c'est l'Apocalypse. Ou quelque chose comme ça.
Riders of the Purple Sage est de ces bons westerns qui n'ont ni la possibilité ni la prétention d'être autre chose qu'un bon western. Plein de belles images et de caractères trempés aux paroles aussi simples que leurs costumes. La réalisation est propre, les accessoires sonnent authentique, le casting est excellent. Riders of the Purple Sage est un film à voir. Vraiment.
Riders of the Purple Sage, enfin, s'appelle Les Cavaliers de la Mort en français. Les voix du Seigneur...
mercredi 9 janvier 2013
Random work of wow : Atomic pulp and other meltdowns
Parfois, les scénaristes ont une idée étrange, les éditeurs s'emballent, les presses se mettent en marche, et de nulle part surgit n'importe-quoi.
Ainsi, en 1985, en pleine Mad Max craze, Jonah Hex, le plus élégant (sic) des cowboys de l'univers comics, se voit projeté de son XIXème siècle nord-américain vers un futur poussiéreux qui sent bon l'outback australien. Ca a duré dix-huit épisodes, c'était nul, c'la va sans dire, mais c'était surtout une très mauvaise idée.
Ainsi, en 1985, en pleine Mad Max craze, Jonah Hex, le plus élégant (sic) des cowboys de l'univers comics, se voit projeté de son XIXème siècle nord-américain vers un futur poussiéreux qui sent bon l'outback australien. Ca a duré dix-huit épisodes, c'était nul, c'la va sans dire, mais c'était surtout une très mauvaise idée.
Inscription à :
Articles (Atom)