-
Pulp !
- Vous dites ?
- Je dis...
Pulp !
- Cela signifie quoi ?
- Rien... et tout !
- Pourtant, qu'est ce que c'est ?
- Aucune chose... mais cependant quelque-chose !
- Enfin, que fait-il ce quelque-chose ?
- Il fait rêver !
d'après Souvestre et Allain, Fantômas, 1910.
Le
pulp est un format typiquement 'ricain issu des folies éditoriales de son époque, d'une envie de démesure tout à fait nord-américaine et d'une culture en plein
boom après la conquête de l'ouest (qui s'achève dans les années 1880, c'est moins de trente ans avant la première guerre, ne l'oublions pas). Le
pulp est aussi un format qui ne ressemble à aucun autre, à la durée de vie ultra-courte, avec son histoire, ses idéau(logies)x propres et son héritage, mais le
pulp n'est pas arrivé comme par enchantement. Rejeton des
dime novels et des
serials des journaux à grande distribution, il doit son existence aux exports français et anglais du XIXème siècle, aux enfants et amis de
Féval (père) et
Conan Doyle, de
Verne et
Rider Haggard : les
Twain et les
Eden Southworth, les
Poe et les
Fenimore Cooper.
Partant de cette parenté commune, comment ont évolués les romans-feuilletons chez nous par rapport aux leurs cousins outre-atlantique ? Qui sont nos héros de la période
pulp, nos
d'Artagnans du début du XXème siècle, qui bondissaient de toits en toits pendant que Paris résonnait du bruit des pinceaux du Cubisme et des marteaux de l'Art Nouveau ?
Chez nous, on parlera plus facilement de
roman populaire, un type de (para)littérature alors fort peu reconnu mais au succès indéniable. On attribue communément son nom à la création en 1848 de la collection
Romans illustrés par
Gustave Havard et, en 1849, des
Romans populaires illustrés de l'éditeur
Gustave-Émile Barba, mais l'essor du genre était arrivé bien avant, marqué notamment par
Les Mystères de Paris d'
Eugène Sue (roman fleuve débuté en 1813 et qui représente exactement le genre de (pré-)dickenserie dont parle
lavidéoquejevousaipostélasemainepassée -à croire que je prévois mes billets à l'avance, dites donc). Des auteurs et personnages se détachent vite du lot, notamment
Paul Féval (
Le Bossu, 1857),
Pierre Alexis de Ponson du Terrail et son inévitable
Rocambole (1857, auquel on doit, oui, le fameux adjectif), le
Monsieur Lecoq d'
Emile Gaboriau (1866), considéré à plus d'un titre comme le premier "super-détective" de l'histoire, et bien évidemment l'incomparable
Alexandre Dumas, publiés dans des organes de presse au développement ultra-rapide comme
Le Petit journal (créé en 1863). L'âge d'or de ces publications arrivera entre 1880 et 1900, avec l'explosion de genre particuliers comme les "romans de la victime" et, surtout, la création d'éditeurs populaires (
Rouff,
Fayard,
Tallandier) qui vont réellement permettre d'imposer un marché (le gouvernement ira jusqu'à accorder à
Hachette l'exclusivité des ventes sur la route du rail, occasionnant la création du terme "roman de gare"). Toutefois, le roman populaire tel qu'on le conçoit communément est vraiment un type de fiction très particulier, et le siècle nouveau va s'intéresser à une autre littérature, qu'on aura bien du mal à qualifier de "moins sociale" mais dont la portée s'avère radicalement différente, et portée notamment par l'aventure "scientifictionelle" d'un
Verne et les progrès réels et avérés de la science.
Par commodité, on s'accorde à dater les
pulps entre 1896, date à laquelle
Argosy (magazine créé en 1882) publia son premier numéro entièrement dédié à la fiction, et 1942, au coeur de la pénurie de papier qui secoua l'édition nord-américaine, la période étant marquée, donc, par le format particulier des magazines, à 10
cents ("
a dime") les 120 pages, imprimés sur du papier qui n'en mérite même pas l'appellation (et qui fait qu'on a un mal de tous les diables à en conserver/retrouver en bon état un siècle plus tard). Si l'on n'a pas eu droit aux modèles enclumesques des
pulp magazines proprement dits sous nos latitudes, le type de littérature qu'ils contenaient et l'élan nouveau quelle apportait a bel et bien sévi dans nos journaux et nos fascicules "à quatre sous". Pour s'en rendre compte, je prendrai sensiblement les même dates concernant les publications françaises, débutant avec l'Exposition Universelle de Paris en 1900 et m'arrêtant à la réddition de 1940.
Bien sûr, on pourrait commencer plus tôt et finir plus tard, dans les années 1880 (j'ai eu très très envie de débuter avec la parution des
Xipéhuz de
Rosny aîné) et après la libération, par exemple, mais il suffit de lire les productions du moment pour comprendre où et comment faire le tri. Il y a un monde qui sépare l'âge d'or de
Verne et
Sue d'écrivains aux sujets similaires comme
Le Rouge et
La Hire : quoiqu'on soit encore en pleine belle époque (jusque 1914, s'entend), ces auteurs n'appartiennent pas au même siècle, et ça transpire de chaque page. Quant à la Deuxième Guerre, même si les publications ne cessent pas sous l'occupation (le fameux
Passe-Muraille de
Marcel Aymé sort en 1941 dans les pages de
Lectures 40, une revue de la zone occupée, par exemple), c'est un sujet entièrement différent de l'histoire éditoriale française, un flou publicationnel de cinq ans où certaines séries sont souvent biface (une occupée, une libre) qui mérite son propre segment.
Evidemment, tout ça n'empêchera aucunement de déborder un peu (les
Voyages excentriques de
Paul d'Ivoi débutent en 1894,
Rosny est définitivement un auteur qui comptera autant dans la fin du XIXeme que le début du XXeme et on ne manquera sous aucun prétexte les publications en temps de guerre de
Jean Ray), mais je pense que ces dates permettent de délimiter, si pas une frontière éditoriale stricte, au moins un contexte créatif bien particulier.
Maintenant qu'on a nos dates, voyons-voir les sujets. Ma question ici, plus que "y a-t-il un
pulp français", devrait plutôt se poser ainsi : "peut-on le considérer comme du
pulp ?", c'est-à-dire, plus qu'un support, comme un véritable genre, multistrate et particulier, représentatif à plus d'un titre de son époque ?
Les publications d'alors ont bien évidemment cette folie urbaniste exploratrice et sciencefictionnelle qui secoue l'ensemble du paysage littéraire du moment, la faute à
Verne et
Wells, notamment, mais a-t-on nous aussi eu doit à cette libération post-humaine que sont les héros en capes, à cette envie de grands espaces qui enverra
John Carter sur Mars, à ce besoin d'évasion historique qui fera la gloire imaginaire de l'ouest ? Pour faire simple : oui. Vous pensez bien que je n'me serais jamais lancé dans cette exploration si c'n'avait pas été le cas. Il y a toutefois deux petites choses à noter avant de détailler tout ça, qu'il faut impérativement prendre en compte et qu'il me sera difficile de répéter à chaque fois : autrement plus chargé historiquement qu'une Amérique vieille de cent-trente ans, l'Europe du début du XXème siècle est particulièrement marquée par le passage de l'euphorie victorienne des expositions universelles (celle de 1900 sera justement la plus fréquentée de l'histoire) à une réalité scientifique (les premiers vols motorisés des frères Wright en 1903, la relativité d'Einstein en 1905), et, entre les théories futuristes et les évolutions sociales, par une terreur que l'Amérique ne peut qu'imaginer de loin : la guerre. (Rappelons qu'alors que les Etats-Unis sortent de leur guerre civile (1861-65) et sont en 1900 au fait d'une longue phase de désarmement -qui s'arrêtera comme chacun sait en 1917-, la IIIème République prépare "La Revanche" depuis 1870.)

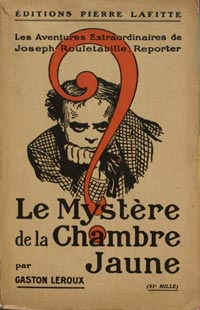
Comme l'Amérique, la France est marquée par la prédominance du genre policier et un urbanisme particulier au début de siècle.
Gaston Leroux s'y fait un peu le
Dashiell Hammett français (sauf qu'il préfigure le Surréalisme au lieu du roman Noir -
Le Mystère de la chambre jaune, première aventure de
Rouletabille, en 1907-), et
Arsène Lupin (1905),
Fantômas (1911) et
Judex (1917) trouveront de quoi donner à nos héros le goût de mélanges justiciers entre nos
génies du crime (instaurés par
Rocambole) et ce que deviendront les
mystery men américains (le
Shadow et ses suiveurs). Toutefois, la vision française est plus hiérarchisée, moins franche et outrée, plus élégante et sophistiquée. Paris est une ville d'Art, voyez-vous, on n'est pas des
cow-boys, et même en province, on cultive un raffinement rustique, comme le montrera
Maigret à partir de 1930.
Ce qui n'empêche pas une certaine gratuité :
Paul d'Ivoi ajoute une touche d'espionnage (
X.323, 1908) à ses romans d'aventure (
Les Voyages excentriques, que j'évoquais plus tôt), proches de
Verne mais en beaucoup plus
pop et décousus,
Burroughs avant l'heure, en fait, où les machines futuristes n'ont aucune explication, où on visite des tombeaux/découvre des civilisations sans la moindre considération et où on vainc des monstres/savants fous/tyrans mégalos à la pelle. Ou alors, on va de par le monde dans une longue quête d'apprentissage, comme chez
André Armandy (
Les Réprouvés, 1926,
Le Trésor des îles Galapagos, même année), redorant au passage le blason du colonialisme (une des pierres angulaires de la fiction de gare de l'entre-deux-guerres).
Pierre Benoit, futur académicien à la carrière littéraire relativement modeste, verse lui dans l'onirisme pur et dur, notamment dans
L'Atlantide (1919), et fait de l'amour le moteur particulier de ses récits (ce qui sonne, là encore, particulièrement burroughsien à mes yeux).
On se teinte aussi de fantastique, dans un paysage littéraire encore emprunt du gothique romantique de
Poe et
Baudelaire et où naît le Surréalisme absurde, avec des personnages comme le
Fantôme de l'Opéra de
Gaston Leroux (1909) ou le
Belphegor d'
Arthur Bernède (1927, pensé comme un concurrent de
Judex, les deux personnages étant issus du cinéma et scénarisés par
Bernède lui-même), voire le
Monsieur d'Outremort de
Maurice Renard, des inventions étranges comme l'inexpliqué "
Rour" de
Souvestre et
Allain (qui préfigure
Fantômas), et des auteurs prolifiques comme le belge
Jean Ray (qui sera, pour l'anecdote, publié dans
Weird Tales sous le pseudonyme
John Flanders -il est flamand,
blague-), toutefois plus connu à l'époque pour
Harry Dickson, le Sherlock Holmes américain, une série allemande de 1907 qu'on traduira (et adoptera) très vite (dans
La Nouvelle populaire, la même année) avant que
Ray ne l'écrive lui-même à partir de 1929 (il y aura au total 178 numéros, jusqu'en 1938).
Parmi les héros sériels, quelques archétypes de super-héros apparaissent, fortement teintés de SF à l'image du
Nyctalope en 1911, qu'on désigne souvent comme le premier personnage "à super-pouvoirs" de la littérature (et de TOUTE la littérature, pas seulement francophone) et de
L'Homme élastique de
Jacques Spitz (1938), ou sous les traits de grands magiciens comme
Sâr-Dubnotal (1909, dont la paternité est prêtée à
Norbert Sévestre mais n'a jamais été prouvée), hypnotiseur émérite non sans rappeler un (pré-)
Mandrake en turban, et son successeur
Fascinax (1921, auteur anonyme).
On visite d'autres mondes également,
Arnould Galopin enverra ainsi le
docteur Omega sur Mars (
Aventures fantastiques de trois français dans la planète Mars) en 1906 quand
Gustave Le Rouge y trouvera un
Prisonnier en 1908, année où
Jean de la Hire, futur auteur du
Nyctalope, revisitera
La Guerre des mondes dans sa
Roue fulgurante, avant que
l'abbé Moreux n'en reçoive des signaux dans son
Miroir sombre en 1911 ; j'en passe (beaucoup), et pas des moins bons (les années 1890/1910 ont un
truc avec Mars, la faute à
Giovanni Schiaparelli). Citons aussi
Maurice Renard et les arachnoïdes invisibles du
Péril Bleu (1910),
La Guerre des mouches de
Jacques Spitz (1938), considéré comme un des premiers grands romans du genre, et comment oublier
Rosny aîné, dont le premier roman, en 1895, était une fable SF étonnement avant-gardiste, et qui publiera, oscillant entre l'aube et la fin des temps, de la SF (
La Mort de la terre, 1910,
Les Navigateurs de l'infini, 1925) et de la
fantasy (
La Guerre du feu, 1909,
Ambor le loup, 1931) jusqu'en 1935 ?
Tant qu'à parler de
fantasy, si le médiéval fantastique est loin alors d'avoir pénétré le territoire, le roman historique "de cape et d'épée" est en pleine santé, et le pendant du
cow-boy américain sera plus que jamais "le mousquetaire" (au sens dumasien du terme), notamment au travers du
Capitan et des
Pardaillan de
Michel Zévaco (entre 1905 et 1918), des nombreuses suites du
Bossu (de 1893 à 1929) et de l'improbable rencontre entre
d'Artagnan et Cyrano (1925) de
Paul Féval fils, et, surtout, de
L'Homme au masque de fer (1931) d'
Arthur Bernède, encore lui, qui marqua durablement les mémoires. Je vous parlerais bien aussi de la figure plus que controversée de
Jean d'Agraives, colabo avéré, voleur patenté (le
Scaramouche de
Sabatini), mais exaltant auteur jeunesse aux nombreux pirates et chevaliers.
Tout ceci, évidemment, sans oublier les classiques à l'eau de rose, qu'on passe par les ultra prolifiques
Max du Veuzit (alias Madame Alphonsine Vavasseur) et
Delly (le frère et la soeur Petitjen de la Rosière), ou
Alain-Fournier et son
Grand Meaulnes, et des oeuvres sociales plus marquées, comme celles du régionaliste suisse
Charles-Ferdinand Ramuz (
La Grande peur dans la montagne, 1925) ou la saga de
Jean-Christophe de
Romain Rolland qui, parue entre 1904 et 1912, sera perçue comme une oeuvre d'amitié franco-allemande et vaudra à son auteur le Nobel de littérature en 1914.
La littérature populaire brasse large, et tous ces récits, selon les modèles en vigueur, passent par une prébublication dans les journaux et périodiques d'alors comme le très populaire
Le Matin (fondé en 1883),
Faits-divers illustrés (1905) ou
Détective (1928, notre
Nouveau Détective actuel), ou dans de nombreux fascicules dédiés (format en vogue depuis le XIXème et qui serait l'ancêtre, si l'ont veut, des magazines autocontenus au nom de leurs héros de l'Amérique des années 30), avant de se retrouver reliés (les fameux "romans de gare") dans des collections comme
Le Roman d'aventure (1908), qui verra notamment passer
Jean de la Hire (dans un récit dont un des personnages n'est autre que le père du
Nyctalope),
Paul d'Ivoi,
Gustave Le Rouge,
Arnould Galopin et même
Pierre Giffard, un des instigateurs du Tour de France, qui fut aussi un excellent auteur jeunesse. (A ce titre, la majeure partie des dates que je donne est sujette à ajustement, puisque j'use interchangeablement des parutions dans la presse et en volume - par exemple,
La Roue fulgurante de
Jean de la Hire est parue dès 1906 dans
Le Matin, mais n'a été relié chez
Tallandier qu'en 1908.)
Le cinéma s'empare évidemment lui aussi du format. Aux
serials américains répondent les feuilletons français, à un rythme fou (
Louis Feuillade adapte cinq romans de
Fantômas entre 1913 et 14), les deux modèles s'inspirant l'un l'autre : on attribuera ainsi aux
Vampires de ce même
Feuillade (1915) l'archétype des femmes fatales à la
Catwoman (le
serial sera par ailleurs lui aussi salué par les surréalistes), et, toujours de
Feuillade, la figure de
Judex (1917), justicier
dandy en chapeau et cape, deviendra l'éminent
Shadow. Un prêté pour un rendu, d'ailleurs, car c'est justement sous le nom de
Judex que le
Shadow apparaîtra dans les premières traductions des
comic strips dans la langue de
Pierre Pelot à la fin des années 30 (titrés
L'Ombre de Judex). Dans un autre genre,
Vidocq, mort depuis une cinquantaine d'année, devient un personnage de cinéma en 1909 sous les traits de
Harry Baur (il n'aura jamais de roman à sa gloire, mais
Vidocq a écrit lui-même et ses mémoires inspireront notamment
Monsieur Lecoq,
Jean Valjean,
Auguste Dupin chez
Poe ou
Rodolphe de Gerolstein chez
Sue, et une bédé dès 1939,
Les Aventures véridiques du policier bagnard Vidocq par
Giffey et
Laude).
Et dans le sillage de l'inévitable
Tintin (1929) apparaissent en Franc(ophoni)e à la fin des années 30 les héros des
comic strips américains, qui déteignent forcément sur les nôtres et s'exportent sur le format (
Arsène Lupin et
Rocambole y arriveront dans les années 40,
Monsieur Lecoq dans les 50), et également dans les magazines de bande dessinées, comme
L'Epervier bleu dans
Spirou, par exemple. On voit aussi arriver de nombreuses bédés de SF, à l'image de
Futuropolis (à l'inspiration évidente) en 1937, pendant que se joue une pseudo-"guerre" frontalière entre le magazine
Tintin bruxellois et le
Journal de Mickey parisien (ça parait absurde de nos jours alors qu'ils sont devenus deux grosses machines à licence, mais
Superman -enfin,
Marc, Hercule moderne ou
Yordi, selon les aléatoires traductions de l'époque- sera publié dans les deux périodiques).
Il y a d'ailleurs à ce titre une chose très intéressante à noter, c'est que si la période d'hyperpopularité du
pulp américain se fait plutôt entre-deux-guerres, avec l'apparition de personnages comme
Conan et
Doc Savage dans les années 30, elle a eut lieu avant 1914 chez nous. Dans les années 20, un désaveu populaire certain marque une franche séparation entre des lecteurs désenchantés et l'enthousiasme patriotique de la presse pendant la guerre (un périodique comme
Le Petit Journal, qui annonçait cinq millions de lecteurs en 1900, voit son chiffre tomber à 400mille en 1919 alors que les élans politiques de sa rédaction s'affirment), et puis le contexte des années folles va réellement faire décoller le cinéma.
Le début du siècle littéraire est emprunt des évolutions scientifiques et artistiques, jusqu'à s'inspirer mutuellement (les illustrations de cet article cachent -bien mal- un tableau du cubiste
Juan Gris et un autre du surréaliste
Magritte), les péripéties absurdes, anticipations insensées et évocations graphiques de certaines aventures devenant autant d'étendards picturaux, de modèles de pensées nouveaux voire de manifestes de
vies nouvelles, chaque récit étant marqué, tous comme ses cousins américains, autant d'impératifs économiques que d'une indiscutable effervescence créative. Le XXème siècle n'est plus le XIXème, et loin de s'en être simplement rendu compte, sa frange fictionnelle la plus gratuite s'en est carrément faite apôtre. Une observation qui, si elle est indéniablement plus palpable dans la littérature parisienne, se fait des deux côtés de l'Atlantique et donne naissance, bien au delà de leurs formats de distribution, à des pratiques narratives curieusement analogues.
Et comme en Amérique et comme je l'ai précisé plus tôt, j'arrête mon historique avec la Deuxième Guerre, de manière assez aléatoire mais pas innocente. Les magazines de fiction et romans-feuilletons continuent bien évidemment sous l'occupation, mais la scission de la France fait de ces quelques années un monstre éditorial complètement fou. Et après la libération, c'est l'explosion... Les années 50 verront le développement du format poche, et la fiction populaire sera publiée hors des journaux et des magazines, exactement comme aux Etats-Unis. Les fascicules ne disparaissent pas pour autant, mais prennent la forme de véritables magazines au sens moderne. Devant l'expansion du marché, il n'est plus question de parler de "
pulp" ou de "roman de gare" en rassemblant tout et n'importe-quoi, la littérature "de genre" se développe comme elle n'avait encore jamais pu le faire, et il devient rapidement nécessaire de nommer ses branches avec précision. On commence réellement à parler de SF, de
fantasy, de
spyfy, et à les historier. Apparaissent alors
Nestor Burma (1943),
Fantax (1946),
Blake et Mortimer (1946),
Tarou (1949),
OSS 117 (1949), des auteurs comme
Jimmy Guieu, qui fit la gloire de
Fleuve Noir Anticipation (dès 1954),
Albert Bonneau, spécialiste du
western, ou
Georges Chaulet, empereur du
pulp jeunesse (
Fantômette,
Les 4 as, c'est lui), des magazines comme
Vaillant (1945),
Fiction (1953, lié au
Magazine of Fantasy and Science-Fiction, leader du
pulp nord-américain) ou
Météor (1953), qui mèneront à
Métal Hurlant,
Rahan,
Blade,
Henri Vernes et des tas de magazines/bédés/personnages/auteurs fascinants qui donnent à la liste des choses franco-françaises dont je veux parler des allures de Manuscrits de la Mer Morte déroulés dans le désordre... et j'adore ça.
Oh, et un dernier petit détail : d'
Arsène Lupin à
Rouletabille, de
Gustave Le Rouge à
Rosny aîné, la très large majorité des titres et auteurs que je liste ici est disponible libre de droits au format numérique, si la curiosité vous y conduit...
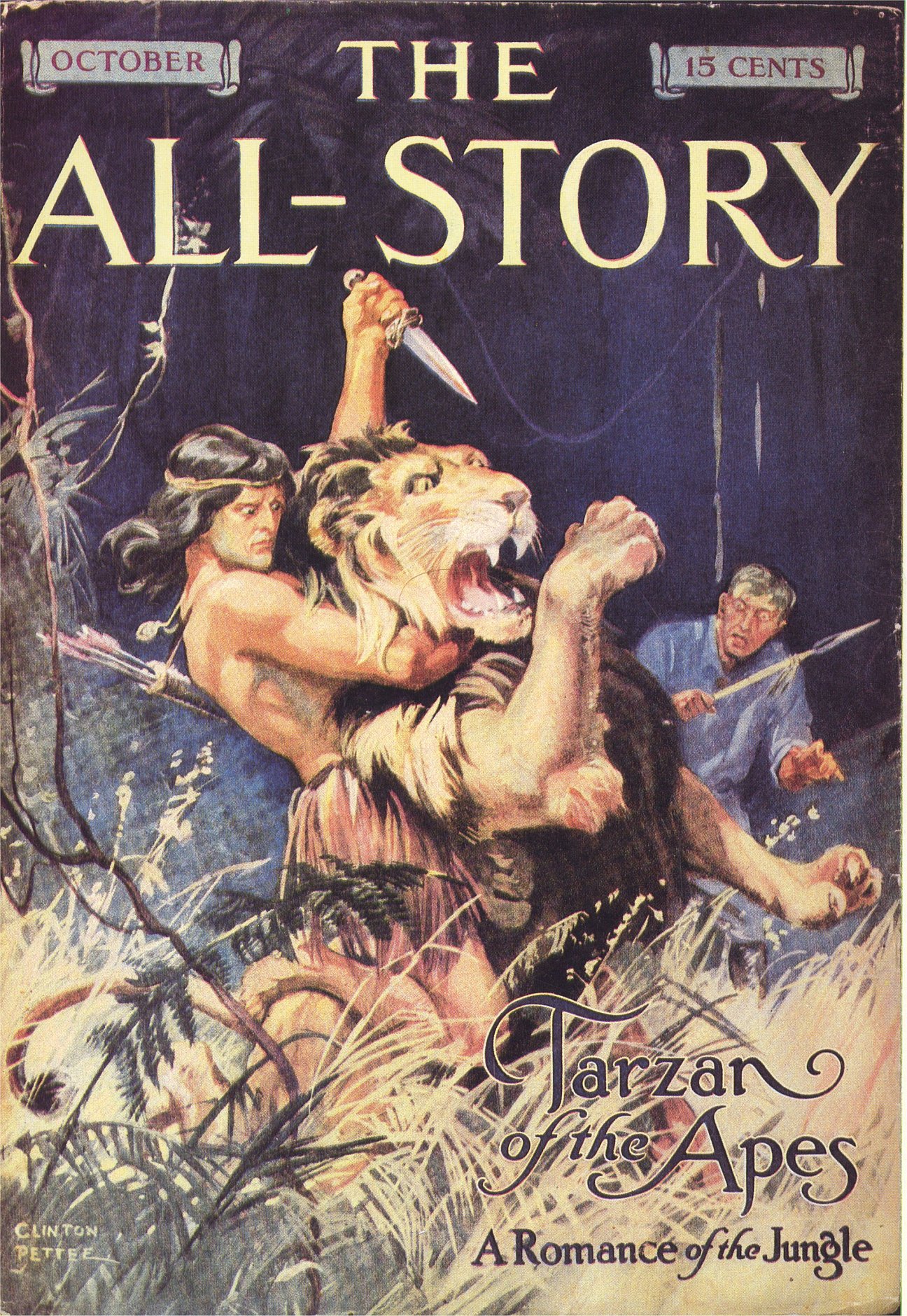 La vérité, c'est que la majeure partie des blancs civilisés qui débarquent dans la jungle sont en fait absolument incapables de s'en sortir sans l'aide (voulue ou non) de Tarzan. Jetez un oeil à la couverture que je vous ai mise sur la droite : c'est la toute première image de Tarzan jamais éditée, lors de sa parution dans All-Story en octobre 1912, sous le pinceau de Clinton Pettee. Tarzan y combat vaillamment un lion, mais pourquoi un tel affrontement ? Pour défendre le petit gars derrière, William Cecil Clayton, le prétendant tout propre et bien éduqué de Jane, qui assiste, impuissant, les yeux exorbités, à la joute.
La vérité, c'est que la majeure partie des blancs civilisés qui débarquent dans la jungle sont en fait absolument incapables de s'en sortir sans l'aide (voulue ou non) de Tarzan. Jetez un oeil à la couverture que je vous ai mise sur la droite : c'est la toute première image de Tarzan jamais éditée, lors de sa parution dans All-Story en octobre 1912, sous le pinceau de Clinton Pettee. Tarzan y combat vaillamment un lion, mais pourquoi un tel affrontement ? Pour défendre le petit gars derrière, William Cecil Clayton, le prétendant tout propre et bien éduqué de Jane, qui assiste, impuissant, les yeux exorbités, à la joute.
