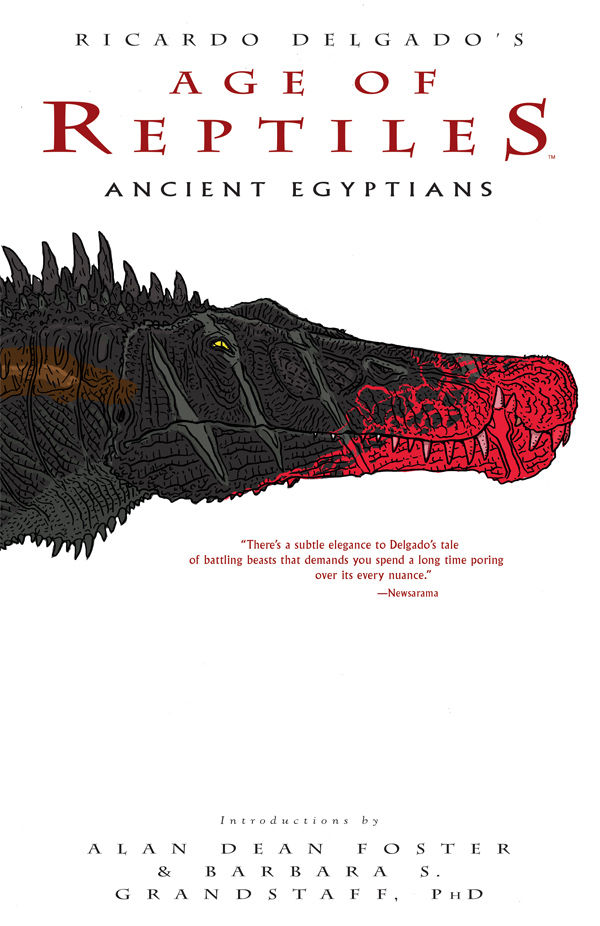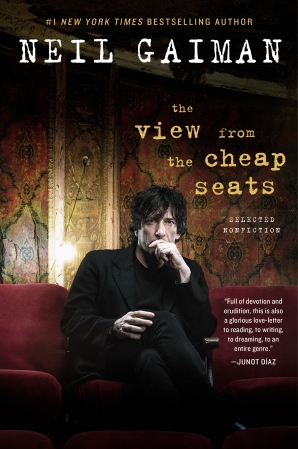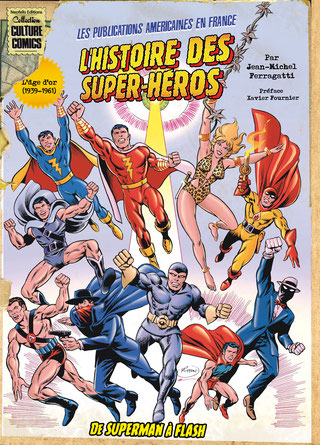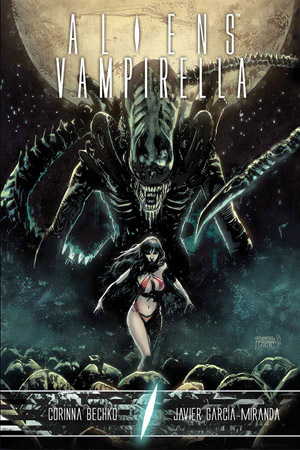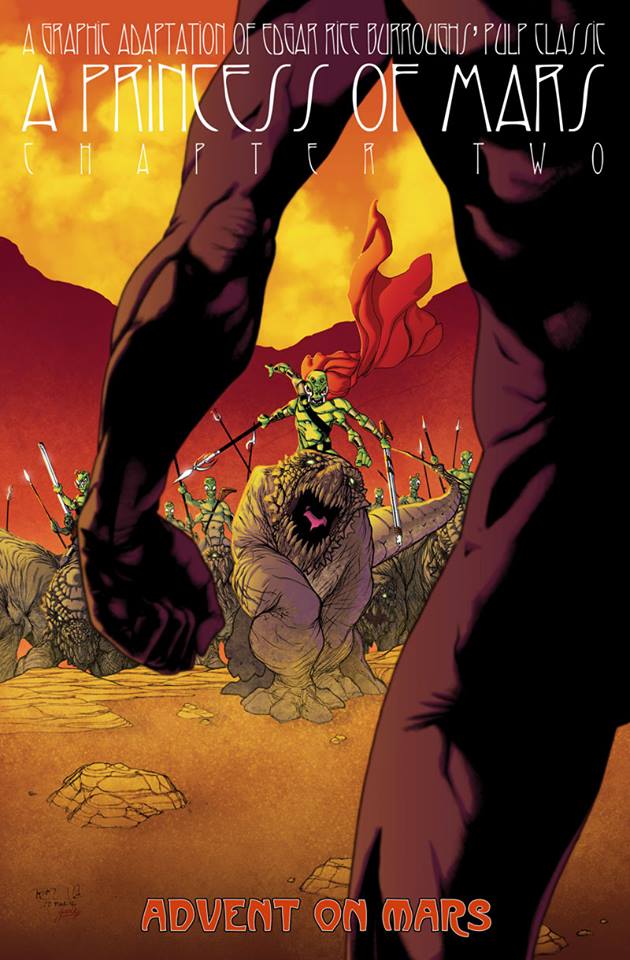Serge Lehman et Frederik Peeters - L'Homme gribouillé (Delcourt, 17 janvier)
"Serge Lehman et le pouvoir des histoires", prise... 253, peut-être ? Sans temps mort, L'Homme gribouillé commence comme un polar, dévie vers l'espionnage et les société secrètes, et termine en apothéose folklorique fantastique ; une histoire qui parfois à l'air de se perdre et de partir n'importe-où et qui, soudain, fait de nouveau sens, quand toutes les pièces s'assemblent. Ce qui lie le tout, c'est le rythme du récit, Lehman parvenant à écrire une enquête ésotérique à l'ambiance résolument noire, à la situer en 2015, et à tirer toutes les bonnes ficelles en chemin pour ne pas finir avec une espèce de vieille fable boursouflée. Il y a comme un souffle, une attente, et quand le fantastique frappe (au sens propre), il le fait brutalement et l'espace d'une scène choc, avant qu'on ne revienne au froid quotidien, ponctuant très efficacement le récit. J'avouerais bien un flottement quant à la manière dont tout ceci est résolu, probablement trop brusquement (ça mérite un épilogue, même s'il annihilerait l'effet poétique), mais c'est typiquement le genre de bédé que j'ai gardée ouverte une fois terminée, revenant en arrière non pas pour admirer les planches (très élégantes mais avant-tout fonctionnelles et au sens narratif racé, Frederik Peeters n'est pas un manche) mais pour relire les bulles les plus explicatives à la recherche du détail manqué ou manquant. et, comme dans tout bon polar, la relecture en connaissance de cause prend un tout autre sens. J'étais déjà (très) amateur du boulot pulp de Serge Lehman, je crois que je vais devenir fan tout court.
Kij Johnson - La Quête onirique de Vellitt Boe (Belial, 15 février)
Après Smith l'an dernier, c'était au tour de Lovecraft d'être à la mode, à commencer par un gros Ulule d'intégrales made in Mnémos (auquel je n'ai pas participé cette fois - déjà, c'était deux fois plus cher que Smith, mais surtout, la totale de Lovecraft, j'en ai déjà deux*) mais aussi un mois dédié par le collectif des Indés de l'imaginaire (ActuSF, Hélios, Mnémos et Les Moutons électriques). Evidemment, au milieu de tant de parutions, pas mal de trucs attirèrent mon oeil, notamment Sherlock Holmes et les ombres de Shadwell de James Lovecroft (premier volume d'une série sur une base semi-réelle de manuscrit retrouvé, un peu à la manière des Mangeurs de morts de Crichton), le très drôle Celle qui n'avait pas peur de Cthulhu de Karim Berrouka (dont on va reparler très vite) et La Ballade de Black Tom de Victor Lavalle (qui fait avec L'Horreur de Red Hook exactement ce que fait la quête de Vellitt Boe avec celle de Kadath l'inconnue - les deux ont même vécu leur première parution conjointement dans le Reinventing Lovecraft de Tor.com en 2016), maiiiisss celui qui m'intriguait le plus, c'était le premier roman traduit en français de Kij (prononcez "kidje") Johnson. Universitaire multirécompensée (Hugo, Nebula, Locus, Sturgeon, World Fantasy Award, Asimov's Readers Choice...), madame Johnson n'a eu droit qu'à deux réelles (comprendre "hors magazines") parutions en VF, toutes deux chez Belial : la nouvelle Un pont sur la brune dans la désormais inévitable collection Une heure lumière en 2016, et, donc, cette quête onirique à la parenté évidente. Sauf que Lovecraft et Johnson ont deux manière radicalement opposées de penser les même idées, cette dernière voguant sur des rives plus pratchetto-gaimaniennes (et une touche de Dunsany, dont on cite la Carcassonne fantastique dès les premières pages) que purement horrifiques, et si l'on est bien dans la contrée des rêves et qu'on en retrouve tout le sel, des chats aux cauchemars en passant par les anciens endormis et les clés magiques (un tas de références pour amateurs qui, par ailleurs, en fait également une parfaite porte d'entrée pour qui n'a jamais lu les aventures de Randolph Carter), on est dans un tout autre contexte. Ce n'est pas la première fois qu'un auteur revisite cette partie du mythe lovecraftien (Brian Lumley, pour ne citer que lui, y avait déjà fait un tour dans les années 80), mais Johnson s'inscrit véritablement en miroir, ce qui est d'autant plus agréable dans une période éditoriale où l'adjectif commence à avoir une valeur aussi floue et aléatoire que son cousin "shakespearien" : ici, on a un livre qui fait littéralement du Lovecraft, mais retourne le concept sur sa tête. A la fois suite et réponse à la nouvelle d'origine, difficile ainsi d'échapper à l'évidente envie de la romancière de corriger les manquements du Grand Taré de Providence (son racisme et sa mysoginie, surtout - l'interview en postface est une superbe lettre d'intention) poussant l'exercice jusqu'à signer l'inverse total d'une quête initiatique, dont l'héroïne est une professeure dans la fleur de l'âge tentant désespérément de sauver le monde des erreurs de jeunesse d'une de ses élèves ; une aventurière tirant sa force non pas de sa fraîcheur physique et de sa témérité mais de longues réflexions et d'années d'expérience. En résulte un livre qui aurait pu se faire formuléique (prendre un élément de Lovecraft, l'inverser, et "voila") mais qui s'avère particulièrement enchanteur, doucereux et posé, contemplatif et introspectif, qui me rappelle une espèce de C.L. Moore du XXIème siècle, ô combien différent de ce qu'on imagine d'un roman inspiré plus ou moins directement du mythe de Cthulhu (quoique le Cycle des Rêves soit quand même un truc bien à part chez Lovecraft), et juste pleinement excellent. Chose amusante, en 2003, Kij Johnson avait écrit l'opposé polaire de ce livre, Fudoki, pour le coup véritable quête initiatique d'une jeune fille audacieuse et volontaire, mais qui ne fut jamais traduit.... Belial, si tu m'entends...
(* en l'occurrence, les inévitables Bouquins de Robert Laffont avec des tas de suiveurs en bonus, et une édition numérique anglophone, celle de Delphi Classics (par ailleurs une excellente maison d'édition pour ce qui est des collections d'auteurs classiques et/ou tombés dans le domaine public, leur volume dédié à Robert E. Howard est orgiaque, ils ont une collection de sagas nordiques particulièrement réussie et ils font même de la VF, notamment un Alexandre Dumas complet au point d'inclure jusqu'à sa traduction d'Ivanhoé), que j'ai avant-tout parce qu'elle comprend les essais du monsieur -que les Bouquins, centrés uniquement sur la fiction, n'incluent pas-.)
Karim Berrouka - Celle qui n'avait pas peur de Cthulhu (ActuSF, 15 mars)
"Qu'est-ce qui est vert, pèse 120 000 tonnes, pue la vase, n'a pas vu le ciel bleu depuis quarante siècles et s'apprête à dévaster le monde ? Ingrid n'en a aucune idée, et elle s'en fout." C'est, en deux phrases, comme ça qu'ActuSF a vendu le troisième roman de ce trublion de Karim Berrouka, l'ancien chanteur de Ludwig von 88, un habitué du détournement caustique auquel on doit aussi une guerre de fées pétées à la beuh et une invasion de zombies contre des punks (sans compter une pelletée de nouvelles toutes plus barrées les unes que les autres). C'est évidemment ultra vendeur, ça promet du foutraque par palettes entières et du Profond qui suinte par hectolitres, et je n'ai pas précisé que j'en reparlerai pour des prunes. Ce truc est excellent, tout simplement, et se permet, sous son couvert pas sérieux pour un sou, de livrer un fort bon polar ésotérique, une apocalypse pleine de punch et de tension et une héroïne incisive pleine de personnalité (et trentenaire, alors que j'ai longtemps cru, vu le sujet et le titre, qu'on aurait plutôt droit à une ado et à un bouquin "comique" du rayon jeunes adultes - c'qui n'est pas une mauvaise chose en soi, juste, ça n'aurait pas donné la même chose du tout). Evidemment, le gros intérêt du roman tient dans son exploration mordante du canon lovecraftien, exploité au premier degré comme n'importe-quelle théorie du complot mystique dont les adeptes forment sectes et cercles chelou (jusqu'à utiliser l'édition J'ai lu du Mythe de Cthulhu comme littéral Livre de la Révélation), qui laisse les services secrets pantois et les badauds insoupçonneux et moqueurs. Pour ne rien gâcher, le dosage entre comédie et fantastique est au poil, il y a un vrai mystère et, dans la multiplicités de ses situations, le texte a toujours cette capacité de prendre au dépourvu, la satire s'arrêtant pile là où le récit commence, offrant un environnement loufoque mais tout à fait crédible à une intrigue aussi abracadabrantesque que réjouissante dont les personnages principaux sont, logiquement, les premiers à réaliser l'incongruité (et la fatalité, parce qu'on parle quand même de fin du monde, là, un peu, aussi)... On est loin, très loin, des envies inclusives rétroactives de Johnson et Lavalle et du sérieux avec lequel les 80ans de la mort du Grand Taré ont été traités ailleurs - on est là parce que Cthulhu et toutes ces conneries, quand on y réfléchi trois secondes, c'est quand même complètement absurde et vachement rigolo. Ce bouquin est fun.
Douglas Preston - La Cité perdue du Dieu Singe (Albin Michel, 28 mars)
Quand un journaliste du National Geographic (qui s'avère aussi romancier) suit une expédition au coeur de la jungle hondurienne à la recherche d'une cité mythique... et la trouve. C'est, genre, Congo rencontre Z, mais en vrai. L'antithèse absolue de tous les trucs que j'ai listé jusque là. De prime abord, la non-fiction n'est pas un genre bien passionnant ; il s'agit d'y rapporter des choses, d'interpréter des données, de faire l'apologie ou le procès d'idées diverses. Mais lorsqu'il s'agit de bourrer quatre cent pages d'un reportage hyper exhaustif d'une exploration folle d'un coin perdu de la jungle d'Amérique centrale, il y a tout de suite quelque-chose en plus. L'inconnu, le danger, le côté complètement insensé de l'entreprise, et la réalisation sourde et fascinante que quelques âmes aventureuses l'ont bel et bien fait. Le livre de Douglas Preston est ainsi un long rapport, bourré d'explications, dont le premier tiers est intégralement dédié à un long historique des expéditions passés et des recherches effectuées avant de lancer celle dont il nous conte l'histoire, et les innombrables ramifications, notamment écologiques, politiques et économiques, qui en découlèrent. Parce que c'est pas tout de trouver une civilisation inconnue dans des ruines immaculées en 2015, 'faut savoir quoi et comment faire avec après l'avoir trouvée. Et c'est juste passionnant, haletant comme rarement un récit aussi platement terre à terre peut l'être. Entre faussaires géniaux, aventuriers du siècle dernier et scientifiques à la pointe de la technologie, Preston nous fait jongler avec la réalité pas toujours effective de la fameuse Cité, prétendument trouvée par d'innombrables entourloupeurs ou sincèrement méprise par des universitaires trop enthousiastes. Jusqu'à, enfin, une délivrance qu'aucun spoiler (on est dans la vraie vie, les relevés de l'expédition sont librement consultables en ligne depuis l'an dernier et une pelletée d'articles lui a été dédiée, dont évidemment celui de Preston au National Geographic) ne pourra jamais émousser. Steve Elkins, une des grandes figures de la recherche de la cité blanche et instigateur de l'expédition (et de plein d'autres avant) parle dans ses entretiens avec Preston de "virus de la cité perdue". Ce livre est un facteur de contagion.
Jean-David Morvan et Pierre Alary - La Reine de la Côte Noire ; Vincent Brugeas et Ronan Toulhoat - Le Colosse noir (Glénat, 2 mai)
Quand Glénat, à qui on doit déjà trois volumes d'Elric, a annoncé une série de bédés tirées des nouvelles de Conan, évidemment chapeautée par Patrice Louinet (qui signe par ailleurs de très intéressantes postfaces) et dont chaque épisode était confié à une équipe différente, l'idée est apparu comme une évidence. Et pourtant, aussi étrange que ça puisse paraître, il s'agit là de la toute première tentative d'adaptation franco-belge, au format franco-belge, des textes d'Howard. Ever. Quoi de plus logique, alors, que de commencer par ce qui en est immanquablement le texte le plus marquant ? Signée du papa de Sillage et du dessinateur de Sinbad et Moby Dick (un gars qui connait bien la mer, donc), La Reine de la Côte Noire plait surtout par sa fluidité, tant graphique (y a un fond de Tim Sale dans le trait d'Alary qui me plait tout particulièrement) que narrative, offrant une entrée en matière tout à fait pertinente et curieusement (ou pas) très originale, espèce de manifeste d'engagement à ne surtout pas faire comme les bédéastes américains. Indiscutablement, c'est réussi, mais reste que, pour tout ce qu'elle est objectivement excellente, cette nouvelle lecture m'a surtout permis de me rendre compte à quel point, au delà du personnage particulièrement marquant de Bêlit et des idées intrigantes développées par Howard dans la compréhension globale de son héros, La Reine de la Côte Noire est un récit que je trouve de plus en plus fade et froid. Je crois que Conan sans le soufre et le sable, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Alors... alors, il y a Le Colosse noir, épique sourd et épicé plein de magie et de sang (à mes oreilles, il sonne comme une chanson de Demonauta). Au service sur cet épisode, Ronan Toulhoat (que je ne connaissais pas) offre une vision beaucoup plus viscérale de l'Age Hyborien, son Conan est un monstre massif au visage rude, ses paysages sont arides et ses batailles d'immenses visions de cauchemar monochrome. Pour tout ce que la nouvelle elle-même offre de pop et d'infiniment moins recherché que La Reine de la Côte Noire, le trait de cette adaptation lui rend un souffle barbare primaire absolument dantesque. Et non, je n'ai pas choisi ce mot au hasard ; corps tordus, échelle de folie, squelettes, monstres et soldats éventrés, Toulhoat s'est fait plaisir et ça se voit. Et pour être honnête, il n'y a de toute façon rien d'autre à voir dans ces premiers volumes dédiés au cimmérien : les histoires sont connues, et si leur transcription s'avère particulièrement habile d'un point de vue scénaristique (tant Morvan que Brugeas connaissent parfaitement leur medium, et l'usage de "cases flashbacks", d'inserts et de nombreux procédés narratifs typiquement séquentiels changent agréablement le rythme de lecture), c'est bien pour la vision particulière de ses artistes qu'on retiendra cette collection. Et si j'ai préféré me concentrer ici sur la première fournée, comptant que l'automne a aussi vu paraître des tomes 3 et 4 (l'iconique Au delà de la Rivière Noire en septembre et une version considérablement étoffée de La Fille du géant de gel en novembre) plus discrets promotionnellement mais de toute aussi bonne qualité éditorialement, c'est sacrément bien parti.
Melissa F. Olson - Outbreak (Tor.com, 5 juin)
J'ai déjà répété trois ou quatre fois (si pas plus) depuis que je fais ces sélections ne pas aimer coller d'épisodes random de cycles à la numérotation aléatoire, et ça tombe bien, car Outbreak est le dernier volet de Nightshades (au pluriel, à n'pas confondre avec la cochonnerie d'Andrea Cremer, ou avec les Immortals after dark de Kresley Cole, renommés Ombres de la nuit en France), une trilogie de nouvelles policières vampiriques numériques (only, y a pas de version papier de ce truc, et pas de VF non plus). J'ai découvert l'existence de ce charmant projet l'an dernier, lors de la publication du numéro 2 par Tor.com, mais je n'avais pas pris le temps de les lire. Par un hasard fortuit, c'est précisément les bouquins que j'ai lancé sur ma liseuse après avoir terminé Vellit Boe au début du printemps, pile au moment où était annoncée la date de sortie du numéro 3. Il m'a fallu trois chapitres (dont deux d'exposition) pour complètement accrocher au machin ; c'est simple et sans faux-col, c'est du vrai bon polar où tu cherches derrière l'enquêteur, avec, donc, un twist assoiffé de sang pour épicer la sauce. Le truc le plus intrigant dans ces (e-)bouquins est d'ailleurs de prendre ce dernier point un peu par dessus la jambe. Comprenez que les gens de cet univers, sans doute aussi blasés que des millenials en vacances sur la côte normande, n'en ont juste rien à foutre qu'il y ai des vampires dans le monde. Pire!, la seule réaction, ç'a été une série de manifestations concernant des trucs civiques, genre SJW de l'apocalypse urban fantasy. Le parti-pris marche vraiment bien, personne ne veut avoir affaire à ces trucs, l'Etat ne sait pas vraiment traiter le problème (l'apparition des vampires -les "ombres" du titre- est épidémique, avec une maladie pseudo-scientifique proche de ce qu'on peut trouver dans Blade), et les bestioles se baladent plus ou moins à l'air libre depuis des siècles en coinçant des jeunes filles dans les ruelles sombres comme des vieux muggers d'Harlem. Comme toute société secrète, ils sont aussi savamment désorganisés, réunis plus ou moins aléatoirement en petits groupes autour de leaders forts (on n'est pas dans Underworld, c'est pas une armée). C'est à un de ces petits groupes (et à ses tensions internes) qu'a du faire face Alex McKenna, le nouveau boss du Bureau of Preternatural Investigations de Chicago, dans le premier volet, avant d'enquêter sur l'étrange (et sanglante) évasion d'un teenager suspecté d'être un Shade dans le deuxième. Lire les deux à la suite m'avait permis non seulement de prendre en pleine face l'indiscutable évolution (comme si Olson se sentait plus à l'aise avec son sujet) d'une histoire à l'autre, mais surtout d'installer une certaine tension, un truc quasi palpable dans ces étranges histoires (then again, j'adore l'urban fantasy, donc fatalement, ça me hype pas mal), grâce à ses nombreux éléments filés. Explosive conclusion, l'épisode 3 monte encore le voltage d'un cran, mélangeant purement et simplement des versions "cranked to 11" des deux premières intrigues et ajoutant par dessus une couche de discorde en collant les affaires internes au cul du héros et de son assistante, une vampire au passé mystérieux. Le résultat, c'est une course-poursuite à tiroir haletante pleine de secrets et un des tous meilleurs thrillers paranormaux que j'ai lu ces dernières années, expédié vitesse grand V sur environ (trois fois) 150 pages. Bon, 'faut lire l'anglais (car, je le répète, y a pas de VF), mais si c'est le cas, ça pèse moins de quelques heures par épisode si vous lisez aussi vite que moi (et j'lis pas vite), et c'est passionnant.
Paul Maybury - Hunters (Lion Forge, 13 juin)
Le hasard vous fait parfois trouver des choses... hasardeuses. Pitchée et éditée par Paul Maybury (respecté quoique discret auteur de comics indé), scénarisée par Josh Tierney (même remarque) et illustrée par quatorze artistes tout aussi talentueux et inconnus du grand public, Hunters est un épique de fantasy qui rappelle autant la mode récente des aventures nordiques que celle plus ancienne des campagnes de D&D adaptées en roman. C'est, bien basiquement, un mélange entre Beowulf et Dragonlance, et c'est étonnement bien foutu, narré au format anthologique (d'où la profusion d'artistes) afin d'explorer chaque facette des nombreux héros rassemblés dans une quête un peu vaine pour sauver un roi maudit d'un dieu inconnu planqué sur une île abandonnée. Là où le processus créatif devient particulièrement intéressant d'un point de vue narratif, c'est quand on apprend que chaque personnage a été designé par un des illustrateurs (sachant que Maybury en est un également, même s'il ne dessine pas ici), offrant au cast une variété de looks assez intrigante et justifiant d'autant la diversité des styles graphiques et scénaristiques de chaque segment. Parfois bruts, parfois introspectifs, ces derniers créent un environnement de mystère sourd, froid, étrange et inquiétant mais jamais complètement effrayant (bien aidé en ça par la palette globale très pastel) - certaines histoires sont à ce titre particulièrement surprenantes, tirant parfois franchement sur la bédé enfantine, contribuant encore à faire de cette aventure avant tout quelque chose de fantastique et merveilleux, malgré l'inconnu et les dangers. Un bien beau bouquin.
Worlds seen in passing: Ten years of Tor.com short fiction (Tor.com, 4 septembre)
Une compilation de ce qu'un petit blog d'éditeur (Tor/Forge, en l'occurrence) devenu leader de la critique pop et éditeur numérique de son plein droit (en 2014) a eu à offrir depuis son ouverture, quelques mois seulement après sa création en juillet 2008, à la fiction courte. Edité comme il se doit par Irene Gallo (la Directrice de création de Tor Books en personne), avec du Ken Liu, du Marie Brennan, du Kij Johnson, du Jeff Vandermeer et du Cassandra Khaw (et plein d'autres) dedans, l'anniversaire des 10 ans de Tor.com (ce qui me fait au passage me rendre compte que je lis ce site quotidiennement depuis presque 8 ans), c'est 600 pages de voyages dans des mondes étranges, d'enfants perdus dans l'espace, de premiers contacts investigateurs, de privés hardboiled sous les néons et de fashionistas littéralement électriques ; c'est, tout net, la collection de nouvelles la plus impressionnante que j'ai vue ou lue depuis des plombes. Ou comment prouver, l'air de rien, qu'on est bien ce qu'on prétend : plus que le meilleur "magazine" Science-Fiction & Fantasy du web anglophone (avec un paquet de distinctions à son actif), surtout la place où aller lire de la short fiction sur le net. Mon seul regret, c'est le choix de The Sight of Akresa plutôt que Schrödinger's Gun pour Ray Wood. Schrödinger's Gun est, de loin, ma nouvelle favorite de l'interminable catalogue de Tor.com.
Vincent Perriot - Negalyod (Casterman, 5 septembre)
L'une de mes hantises en bédé franco-belge est d'invariablement tomber sur des "volume 1" (cette année, j'ai eu ça avec L'Orphelin de Perdide et L'Age d'or) de trucs qui vont mettre cinq ou six ans à se boucler, si tant est qu'ils se bouclent un jour ("c'est pour dans six mois" disais-je ainsi à propos d'un tome 2 de La Horde du Contrevent... ben makache, j'attends toujours). Alors quand j'en trouve une qui pèse 200 pages de one-shot d'épique science-fictionnel ultraconcentré, avec des dinos partout et une gigantesque cité futuriste en sus, pensez si ça fait papillonner mes paupières. Ce qui est rigolo (rigolo-bizarre, pas rigolo-haha), c'est qu'en dehors d'une liste de références, on en serait presque à avouer ne pas avoir grand chose à dire sur cette bande dessinée. A mi chemin entre la fable écolo et l'anticipation post-apo, Negalyod a une qualité que je ne saurais qualifier autrement que "très 80s" ; on y sent l'influence de Bilal et Hermann, on y voit celle de Moebius et Toff, créant un cocktail aussi original que curieusement familier, mis en scène dans un univers franchement aguicheur, sorte de western paléo-futuriste plein de poussière et de contrôle totalitaire. Emprunt d'une certaine dose de spiritualisme, le récit ultralinéaire se suit sans le moindre déplaisir, manquant peut-être un peu de fond mais certainement pas de caractère. Tout semble être fait et pensé comme un immense hommage informel aux grandes épopées de Metal Hurlant, mais Perriot n'en oublie pas d'être ambitieux, et sa bédé se lit comme un gigantesque kaléidoscope de la SF bédéphile francophone, graphiquement sublime, narrativement serré, immersif et dépaysant. Negalyod, c'est le genre d'oeuvre "comfort-food" à l'idée rafraîchissante mais à la saveur réconfortante qu'on aime avoir (et à voir) dans sa bibliothèque.
Steve Niles et Bernie Wrightson - Frankenstein: Alive, Alive! Complete Collection (IDW, 30 octobre)
En 1983, Marvel publiait une réédition du Frankenstein de Mary Shelley, dans sa version de 1831, complète, avec cinquante illustrations de l'immense Bernie Wrightson (et une préface de Stephen King). Deux décades et plusieurs changements d'éditeurs et de formes plus tard (Dark Horse l'a proposé tel quel en 2008 -c'est la version de référence, éditée en VF chez Soleil-, mais il existe aussi des versions avec uniquement les planches de l'artiste), en 2012, Wrightson revenait au personnage, en compagnie du scénariste Steve Niles (30 Jours de nuit), avec Alive, Alive!. Trois épisodes sortirent, valant à leurs auteurs le National Cartoonists Society's Award en 2013, mais l'histoire demeurait incomplète. Elle l'a été jusqu'à ce printemps, quand IDW rééditait les trois numéros en guise d'apéritif avant un quatrième et ultime épisode (sorti en mars et terminé, à la demande de Wrightson, avec l'aide de Kelley "Sandman" Jones), un an presque jour pour jour après la mort du papa de Swamp Thing et en plein centenaire de la première édition du roman de Shelley. The Complete Collection est, comme son nom l'indique, la première parution a enfin proposer cette étrange histoire dans son intégralité. Alive, Alive! est la suite immédiate du roman, réalisée bien évidemment dans le style de sa "réinvention" par Wrightson et profitant de sa nature apocryphe pour passer du format gravure à une véritable bande dessinée. Loin de la figure iconique de Boris Karloff, la créature y est un monstre cadavérique et noueux (dans un style très proche du Spawn of Frankenstein développé par Len Wein -son compère sur Swamp Thing- au début des années 70), mélancolique et hanté, à la recherche d'un brin d'humanité. Si vous êtes venu pour le grotesque monstre de foire que la pop culture a fait de son incarnation Universal, vous vous êtes trompé de bouquin. Lourdement existentialiste, l'oeuvre fantôme de Niles et Wrightson suinte de l'image et de la pensée gothique dont elle se veut héritière, miroir déformé et déformant de la psyché humaine avant-tout. Le rythme est pesant, chaque retournement profondément fataliste, Niles sait y faire en ambiances et en récits désespérés (on ne lui doit pas la meilleure adaptation séquentielle de Je suis une légende pour rien), parfaitement secondé par la fantastique maîtrise du noir et blanc de Wrightson. Ou est-ce l'inverse ? Le texte, quasi exclusivement en récitatifs, laissant un maximum de place pour que le dessin puisse s'exprimer au fil d'énormes compositions, véritables plaques s'inscrivant clairement dans le style gravure des illustrations d'origine (au point que le disparition de Wrightson soit particulièrement palpable dans les dernières pages, bien plus "BD"). Je dis souvent d'oeuvres qu'elles ont un "souffle", mais rares sont celles qui grondent comme Alive, Alive!. Qu'on ose encore débattre de l'appellation 9ème Art après ce genre de pièce...
A noter qu'en guise de compagnon d'excellent goût, IDW a aussi réédité, dans une superbe reliure noir et blanc, l'adaptation du Dracula de Coppola par Roy Thomas et Mike Mignola (originellement parue -en full color- chez Topps Comics en 1992 et proprement introuvable depuis 25ans). En VF, Alive, Alive! est dispo chez Soleil comme son prédécesseur, et Dracula chez Delcourt.
Milo Marana - Le Caravage, tome 2: La Grâce (Glénat, 28 novembre)
"Enfin !" hurlais-je en mon intérieur de moi-même un beau soir d'automne. Enfin, trois ans après le premier volume, voila les cinquante-quatre dernières planches du diptyque de pinceau et d'épée de Manara. Dédié comme son nom l'indique au grand-maître du clair-obscur, Le Caravage a tout d'une bédé d'aventure, et à raison, tant la vie du peintre a été tumultueuse. Accusé de meurtre, il fuit ici Rome pour aller se planquer dans un cirque... et recommencer à peindre, à bretter, et à dragouner tout ce qui porte une jupe. Non, Le Caravage n'était pas un saint, il était arrogant, susceptible, impulsif et aimait un peu trop les petits(?) plaisirs de la vie, mais il a laissé une oeuvre immortelle, et j'ai du mal à imaginer quelqu'un d'autre que Milo Manara pour illustrer sa vie et l'Italie du tournant du seicento. Ses planches sont un régal, tirant évidement parti de l'appui fortement artistique des tableaux qui les parsèment, et il en recrée décors et drapés avec un plaisir non feint ; c'est baroque, excessif, hyperexpressif, coloré en grosses couches, et c'est magnifique. Loin d'être une simple biographie dessinée (je le répète, mais Michelangelo Merisi da Caravaggio a eu une vie aussi courte -il est mort à 38ans- qu'absolument dingue, et on n'en a ici qu'une version), Le Caravage est un véritable drame épique aux meurs brutaux et charnels, espèce de manifeste tardif du bédéaste, dont il est un projet de longue date, et se fait la parfaite illustration de sa propre oeuvre, ouvertement inspirée des classiques et fruit de cette "école latine" hyperréaliste et outrancière des années 70-80 dont il fut, avec des artistes comme Juan Gimenez, l'un des fers de lance. Et si j'en liste ici le tome 2, il va sans dire que vous devez lire ce truc en entier.
Quelques mentions, à présent, parce qu'il n'y a évidemment pas assez de place dans un top-11.
La Piste du prêcheur, premier tome de Lonesome d'Yves Swolfs, monsieur Durango sur une nouvelle série spagh' au parfum ésotérique (pour une raison aléatoire, le western était d'ailleurs à la mode en début d'année, avec aussi le tome 2 de Duke, que j'ai pas lu, et le 10 de Bouncer, par Boucq tout seul, sans Jodo et sans verve). Edité en VF par le tout jeune Snorgleux comics (qui s'est aussi offert une réédition complète de la saga Elfquest), le premier volume d'Insexts de Marguerite Bennett était fort d'une idée de départ absolument superbe et d'un dessin (signé Ariela Kristantina) tout aussi excellent, mais aussi beaucoup trop comicbook-y et irrégulier dans sa réalisation pour mériter mieux qu'une mention "curiosité". De même pour The Once and Future Tarzan d'Alan Gordon, Thomas Yeates et Bo Hampton, version allongée d'un vieux one-shot de chez Dark Horse, et The Greatest Adventure, crossover fou réunissant tous les héros (et héroïnes) de Burroughs chez Dynamite, deux pulperies pleines de bonnes idées mais aux rendus finaux quelque peu déficients. Oh, et le premier tome des Nanofictions de Patrick Baud, déjà lisibles sur cuicui.
Mentions réédition pour la collection Hellboy Omnibus de Dark Horse, toute la saga dans l'ordre chronologique en six gigantesques volumes pour fêter dignement la fin de la série, et la version anglaise du livre de Bruce "ePenser" Benamran, How to talk science, avec une hilarante préface du précieux Michael "VSauce" Stevens.
Sur un tout autre plan, le comic-strip Nancy, chef-d'oeuvre du minimalisme enfantin vieux de près de 85ans (et un des premiers strips que j'ai lu de ma vie), vient de subir une étonnante révolution sous la plume -encore plus dépouillée- d'Olivia Jaimes, avec force vannes meta et un bon technologique impressionnant (jusque là, le strip était resté sur sa base et n'avait jamais dépassé le niveau technique -ni social- des 50s ; maintenant, on sort son smartphone et on fait des vannes sur les médias) et avec le style deadpan qu'a toujours eu Nancy -et l'inévitable backlash qu'a reçu le changement de la part des vieux fans grégaires-, ça marche à mort. C'est Mark Tatulli, le papa de Lio, qui en parle le mieux.
Je pourrais ajouter des tas de considérations diverses, notamment sur mon esquive volontaire du final du Problème à trois corps de Liu Cixin (je crois que mon attrait pour ce récit s'effrite avec sa progression temporelle, en fait : plus ça va dans le futur, plus j'm'en fous) ou la conclusion de la Trilogie du Rempart (vous savez, Annihilation) parue en VF (chez Acte Sud) pile pour la sortie du film, mais vu ma gueule devant le premier (that thing is scary), on va pas tenter le diable, hein (pas vu le flim non plus, d'ailleurs), ou sur l'absence d'édition numérique de bien trop de livres intéressants (l'intégrale de Perils on Planet X chez Atomic pulp, par exemple, j'ai d'mandé, j'me suis fait envoyé chier comme si j'avais insulté le Livre tout-puissant ; à ce niveau-là j'aurais presque préféré ne pas avoir de réponse), ou sur comment Barbarella réinventée par Dynamite c'est de la merde, mais on va s'arrêter là, ce post est déjà bien assez long.
Tout au plus insisterais-je pour une eulogie pour ma "carrière" de lecteur de superhéros : déjà que ça commence à sérieusement me gonfler au cinéma (Black Panther et Infinity War étaient de belles baudruches racoleuses pleine de vide, sans parler des cochonneries pseudo-subversives à la Deadpool), mais le modèle comics a fini lui aussi par me courir sur le haricot. Le pire, c'est que je filtrais déjà très fin, ayant abandonné Marvel et DC depuis cinq ou six ans maintenant, mais même la vague indé a fini sur le carreau. Le Black Hammer de Dark Horse, pourtant une très bonne série très meta et critique sur le sujet, est parti complètement en banane avec sa mini-série Age of Doom, les dernières absurdités de Dynamite (encore eux...) avec les héros Gold Key m'ont franchement peinées (Sovereign est un non-évènement totalement inconséquent avec une amorce de reboot gritty inutile à la ligne éditoriale plus que douteuse - Magnus passe encore, y a de l'idée à défaut d'une direction, mais Turok, grands dieux... et le cliffhanger final...), et la continuité de Valiant m'a tuer : six ans après, ce qui faisait la force de son univers étendu à l'heure des premiers "Summer of Valiant", quand la boite ne proposait que quatre ou cinq séries en parallèle, est devenu une caravane balourde et envahissante à laquelle il est difficile de trouver un point d'attache : j'ai lu les TPBs du début d'année (Savage, Warmother, un bout de Bloodshot Salvation et le dernier Faith) en diagonale et en hallucinant, il m'a vraiment manqué un gros bout de l'histoire, j'ai pas tout compris c'qui s'passait, et surtout, je me suis rendu compte que je me contrefoutais de comprendre. Ca m'intéresse plus.
Oh, et pour le top cinéma, 'faudra attendre encore un peu. 'Me reste des films à rattraper et les sorties blouré/dévédé/véodé ne se feront pas avant février...